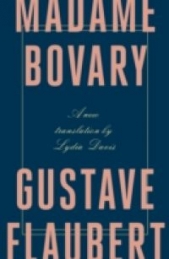Le testament fran?ais

Le testament fran?ais читать книгу онлайн
Ce roman a l’originalit? de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, ? travers les nombreux r?cits que Charlotte Lemonnier, «?gar?e dans l’immensit? neigeuse de la Russie», raconte ? son petit-fils et confident.
Ce roman a re?u le prix Goncourt 1995 et ex-aequo le prix M?dicis 1995.
***
«Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans ga?t?, Charlotte m'avait dit qu'apr?s tous ses voyages ? travers l'immense Russie, venir ? pied jusqu'en France n'aurait pour elle rien d'impossible […]. Au d?but, pendant de longs mois de mis?re et d'errances, mon r?ve fou ressemblerait de pr?s ? cette bravade. J'imaginerais une femme v?tue de noir qui, aux toutes premi?res heures d'une matin?e d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville frontali?re […]. Elle pousserait la porte d'un caf? au coin d'une ?troite place endormie, s'installerait pr?s de la fen?tre, ? c?t? d'un calorif?re. La patronne lui apporterait une tasse de th?. Et en regardant, derri?re la vitre, la face tranquille des maisons ? colombages, la femme murmurerait tout bas: "C'est la France… Je suis retourn?e en France. Apr?s… apr?s toute une vie."»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
II
1
Cet été, j'avais très peur de rencontrer, pour une nouvelle fois, le Tsar… Oui, de revoir ce jeune empereur et son épouse dans les rues de Paris. C'est ainsi qu'on redoute la rencontre avec un ami dont le médecin vous a appris la fin imminente, un ami qui, dans une ignorance heureuse, vous confie ses projets.
Comment, en effet, aurais-je pu suivre Nikolaï et Alexandra si je les savais condamnés? Si je savais que même leur fille Olga ne serait pas épargnée. Que même les autres enfants qu'Alexandra n'avait pas encore mis au monde connaîtraient le même sort tragique.
C'est avec une joie secrète que j'aperçus, ce soir-là, un petit recueil de poèmes que ma grand-mère, assise au milieu des fleurs de son balcon, feuilletait sur ses genoux. Avait-elle senti mon embarras, se souvenant de l'incident de l'été dernier? Ou tout simplement voulait-elle nous lire un de ses poèmes favoris?
Je vins m'asseoir à côté d'elle, à même le sol, en m'accoudant sur la tête de la bacchante de pierre. Ma sœur se tenait de l'autre côté, s'appuyant sur la rampe, le regard perdu dans la brume chaude des steppes.
La voix de Charlotte était chantante comme la voulaient ces vers:
La magie de ce poème de Nerval fit surgir de l'ombre du soir un château du temps de Louis XIII et la châtelaine «blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens»…
C'est alors que la voix de ma sœur me tira de ma contemplation poétique.
– Et ce Félix Faure, qu'est-ce qu'il est devenu?
Elle restait toujours là, à l'angle du balcon, se penchant légèrement par-dessus la rampe. Avec des gestes distraits, elle arrachait de temps en temps une fleur fanée de volubilis et la jetait en suivant son tournoiement dans l'air nocturne. Plongée dans ses rêves de jeune fille, elle n'avait pas écouté la lecture du poème. C'était l'été de ses quinze ans… Pourquoi avait-elle pensé au Président? Probablement, cet homme beau, imposant, avec une élégante moustache et de grands yeux calmes concentra soudain en lui, par quelque jeu capricieux de la rêverie amoureuse, la présence masculine préfigurée. Et elle demanda en russe – comme pour mieux exprimer le mystère inquiétant de cette présence secrètement désirée: «Et ce Félix Faure, qu'est-ce qu'il est devenu?»
Charlotte me lança un coup d'œil rapide teinté de sourire. Puis elle referma le livre qu'elle tenait sur ses genoux et en soupirant doucement, regarda au loin, vers cet horizon où, il y a un an, nous avions vu émerger l'Atlantide.
– Quelques années après la visite de Nicolas II à Paris, le Président est mort…
Il y eut une brève hésitation, une pause involontaire qui ne fit qu'augmenter notre attention.
– Il est mort subitement, à l'Elysée. Dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Steinheil…
C'est cette phrase qui sonna le glas de mon enfance. «Il est mort dans les bras de sa maîtresse…»
La beauté tragique de ces quelques mots me bouleversa. Tout un monde nouveau déferla sur moi.
D'ailleurs, cette révélation me frappa avant tout par son décor: cette scène amoureuse et mortelle s'était déroulée à l'Élysée! Au palais présidentiel! Au sommet de cette pyramide du pouvoir, de la gloire, de la célébrité mondaine… Je me figurais un intérieur luxueux avec des gobelins, des dorures, des enfilades de glaces. Au milieu de cette munificence – un homme (le président de la République!) et une femme unis dans un enlacement fougueux…
Ébahi, je me mis à traduire inconsciemment cette scène en russe. C'est-à-dire à remplacer les protagonistes français par leurs équivalents nationaux. Une série de fantômes engoncés dans des complets noirs se présentèrent à mes yeux. Secrétaires du Politburo, maîtres du Kremlin: Lénine, Staline, Khrouchtchev, Brejnev. Quatre caractères fort différents, aimés ou détestés par la population et dont chacun avait marqué toute une époque dans l'histoire de l'empire. Pourtant, tous ils avaient une qualité en commun: à leur côté, aucune présence féminine et, à plus forte raison, amoureuse n'était concevable. Il était bien plus facile pour nous d'imaginer Staline en compagnie d'un Churchill à Ialta ou d'un Mao à Moscou que de le supposer avec la mère de ses enfants…
«Le Président est mort à l'Elysée, dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Steinheil…» Cette phrase avait l'air d'un message codé provenant d'un autre système stellaire.
Charlotte alla chercher dans la valise sibérienne quelques journaux d'époque en espérant pouvoir nous montrer la photo de Mme Steinheil. Et moi, embrouillé dans ma traduction amoureuse franco-russe, je me souvins d'une réplique qu'un soir j'avais entendue dans la bouche d'un cancre dégingandé, mon camarade de classe. Nous marchions dans les couloirs sombres de l'école, après un entraînement d'haltérophilie, la seule discipline où il excellait. En passant près du portrait de Lénine, mon compagnon avait siffloté de façon très irrespectueuse et affirmé:
– Hé, hé, quoi, Lénine. Il n'avait pas d'enfants, lui. C'est qu'il ne savait tout simplement pas faire l'amour…
Il avait employé un verbe très grossier pour désigner cette activité sexuelle, déficiente, selon lui, chez Lénine. Un verbe dont jamais je n'aurais osé me servir et qui, appliqué à Vladimir Ilitch, devenait d'une obscénité monstrueuse. Interloqué, j'entendais l'écho de ce verbe iconoclaste résonner dans de longs couloirs vides…
«Félix Faure… Le président de la République… Dans les bras de sa maîtresse…» Plus que jamais l'Atlantide-France me paraissait une terra incognita où nos notions russes n'avaient plus cours.
La mort de Félix Faure me fit prendre conscience de mon âge: j'avais treize ans, je devinais ce que voulait dire «mourir dans les bras d'une femme», et l'on pouvait m'entretenir désormais sur des sujets pareils. D'ailleurs, le courage et l'absence totale d'hypocrisie dans le récit de Charlotte démontrèrent ce que je savais déjà: elle n'était pas une grand-mère comme les autres. Non, aucune babouchka russe ne se serait hasardée dans une telle discussion avec son petit-fils. Je pressentais dans cette liberté d'expression une vision insolite du corps, de l'amour, des rapports entre l'homme et la femme – un mystérieux «regard français».
Le matin, je m'en allai dans la steppe pour rêver, seul, à la fabuleuse mutation apportée dans ma vie par la mort du Président. À ma très grande surprise, revue en russe, la scène n'était plus bonne à dire. Même impossible à dire! Censurée par une inexplicable pudeur des mots, raturée tout à coup par une étrange morale offusquée. Enfin dite, elle hésitait entre l'obscénité morbide et les euphémismes qui transformaient ce couple d'amants en personnages d'un roman sentimental mal traduit.
«Non, me disais-je, étendu dans l'herbe ondoyant sous le vent chaud, ce n'est qu'en français qu'il pouvait mourir dans les bras de Marguerite Steinheil…»
Grâce aux amants de l'Elysée, je compris le mystère de cette jeune servante qui, surprise dans la baignoire par son maître, se donnait à lui avec l'effroi et la fièvre d'un rêve enfin accompli. Oui, avant il y avait ce trio bizarre découvert dans un roman de Maupassant que j'avais lu au printemps. Un dandy parisien, tout au long du livre, convoitait l'amour inaccessible d'un être féminin composé de raffinements décadents, cherchait à pénétrer dans le cœur de cette courtisane cérébrale, indolente, semblable à une fragile orchidée, et qui le laissait espérer toujours en vain. Et à côté d'eux – la servante, la jeune baigneuse au corps robuste et sain. À la première lecture, je n'avais discerné que ce triangle qui me paraissait artificiel et sans vigueur: en effet, les deux femmes ne pouvaient même pas se considérer comme rivales…
Désormais, je portais un regard tout neuf sur le trio parisien. Ils devenaient concrets, charnels, palpables – ils vivaient! Je reconnaissais maintenant cette peur bienheureuse dont tressaillait la jeune servante arrachée de la baignoire et emportée, toute mouillée, vers un lit. Je sentais le chatouillement des gouttes qui sinuaient sur sa poitrine pulpeuse, le poids de ses hanches dans les bras de l'homme, je voyais même le remous rythmique de l'eau dans la baignoire d'où son corps venait d'être retiré. L'eau se calmait peu à peu… Et l'autre, la mondaine inaccessible qui me rappelait autrefois une fleur desséchée entre les pages d'un livre, se révéla d'une sensualité souterraine, opaque. Son corps renfermait une chaleur parfumée, une troublante fragrance faite des battements de son sang, du poli de sa peau, de la lenteur tentatrice de ses paroles.
L'amour fatal qui avait fait exploser le cœur du Président remodela la France que je portais en moi. Celle-ci était principalement romanesque. Les personnages littéraires qui se côtoyaient sur ses chemins semblaient, en ce soir mémorable, s'éveiller après un long sommeil. Autrefois, ils avaient beau agiter leurs épées, grimper des échelles de corde, avaler de l'arsenic, déclarer leur amour, voyager dans un carrosse en tenant, sur leurs genoux, la tête coupée de leur bien-aimé – ils ne quittaient pas leur monde fictif. Exotiques, brillants, drôles peut-être, ils ne me touchaient pas. Comme ce curé chez Flaubert, ce prêtre de province à qui Emma confessait ses tourments, je ne comprenais pas moi non plus cette femme: «Mais que peut-elle désirer de plus, elle qui a une belle maison, un mari travailleur et le respect des voisins»…
Les amants de l'Elysée m'aidèrent à comprendre Madame Bovary. Dans une intuition fulgurante, je saisissais ce détail: les doigts graisseux du coiffeur qui habilement tirent et lissent les cheveux d'Emma. Dans ce salon étroit, l'air est lourd, la lumière des bougies qui chasse l'ombre du soir – floue. Cette femme, assise devant la glace, vient de quitter son jeune amant et se prépare maintenant à revenir chez elle. Oui, je devinais ce que pouvait ressentir une femme adultère, le soir, chez le coiffeur, entre le dernier baiser d'un rendez-vous à l'hôtel et les premières paroles, très quotidiennes, qu'il faudrait adresser au mari… Sans pouvoir l'expliquer moi-même, j'entendais comme une corde vibrante dans l'âme de cette femme. Mon cœur résonnait à l'unisson. «Emma Bovary, c'est moi!» me soufflait une voix souriante venant des récits de Charlotte.