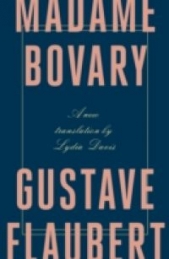Le testament fran?ais

Le testament fran?ais читать книгу онлайн
Ce roman a l’originalit? de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, ? travers les nombreux r?cits que Charlotte Lemonnier, «?gar?e dans l’immensit? neigeuse de la Russie», raconte ? son petit-fils et confident.
Ce roman a re?u le prix Goncourt 1995 et ex-aequo le prix M?dicis 1995.
***
«Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans ga?t?, Charlotte m'avait dit qu'apr?s tous ses voyages ? travers l'immense Russie, venir ? pied jusqu'en France n'aurait pour elle rien d'impossible […]. Au d?but, pendant de longs mois de mis?re et d'errances, mon r?ve fou ressemblerait de pr?s ? cette bravade. J'imaginerais une femme v?tue de noir qui, aux toutes premi?res heures d'une matin?e d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville frontali?re […]. Elle pousserait la porte d'un caf? au coin d'une ?troite place endormie, s'installerait pr?s de la fen?tre, ? c?t? d'un calorif?re. La patronne lui apporterait une tasse de th?. Et en regardant, derri?re la vitre, la face tranquille des maisons ? colombages, la femme murmurerait tout bas: "C'est la France… Je suis retourn?e en France. Apr?s… apr?s toute une vie."»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Elle trébucha, tomba à genoux. Le reste fut si rapide qu'elle crut ne pas avoir touché le gravier blanc du remblai. Deux mains lui serrèrent fortement les côtes, le ciel décrivit un brusque zigzag, elle se sentit propulsée dans le wagon. Et dans un éclair lumineux, elle entrevit la casquette d'un cheminot, la silhouette d'un homme qui, une fraction de seconde, se profila à contre-jour entre les parois écartées…
Vers midi, le convoi traversa Minsk. Dans la fumée épaisse, le soleil rougeoyait comme celui d'une autre planète. Et d'étranges papillons funèbres – de grandes floches de cendre – voltigeaient dans l'air. Personne ne pouvait comprendre comment, en quelques heures de guerre, la ville avait pu se transformer en ces enfilades de carcasses noircies.
Le train s'avançait lentement, comme à tâtons, dans ce crépuscule carbonisé, sous un soleil qui ne faisait plus mal aux yeux. Ils s'étaient déjà habitués à cette marche hésitante et au ciel rempli de rugissements d'avions. Et même à ce sifflement strident au-dessus du wagon suivi d'une giclée de balles sur son toit.
En quittant la ville calcinée, ils tombèrent sur les restes d'un train éventré par les bombes. Plusieurs wagons étaient renversés sur le remblai, d'autres, couchés ou encastrés dans un monstrueux télescopage, encombraient les rails. Quelques infirmières, plongées dans une torpeur d'impuissance devant le nombre de corps étendus, marchaient le long du convoi. Dans ses entrailles noires on voyait des contours humains, parfois un bras pendait à une fenêtre brisée. Le sol était recouvert de bagages éparpillés. Ce qui étonnait surtout, c'était la quantité de poupées qui gisaient sur les traverses et dans l'herbe… L'un des wagons restés sur les rails avait sa plaque d'émail où l'on pouvait lire la destination. Perplexe, Charlotte constata qu'il s'agissait du train qu'ils avaient manqué ce matin. Oui, ce dernier train pour l'Est qui avait respecté les horaires d'avant la guerre.
À la tombée de la nuit, la course du train s'accéléra. Charlotte sentit sa fille se caler contre son épaule et frissonner. Elle se releva alors pour libérer la grande valise sur laquelle elles étaient assises. Il fallait se préparer pour la nuit, retirer les vêtements chauds et deux sacs de biscuits. Charlotte entrouvrit le couvercle, plongea sa main à l'intérieur et se figea, ne pouvant réprimer un cri bref qui réveilla ses voisins.
La valise était remplie de vieux journaux! Dans l'affolement de ce matin, elle avait emporté la valise sibérienne…
Sans pouvoir encore en croire ses yeux, elle tira une feuille jaunie et dans la lumière grise du crépuscule, elle put lire: «Députés et sénateurs sans distinction d'opinion avaient répondu avec empressement à la convocation qui leur était adressée par MM. Loubet et Brisson… Les représentants des grands corps de l'Etat se groupaient dans le salon Murat…»
D'un geste somnambulique, Charlotte referma la valise, s'assit et regarda autour d'elle en secouant légèrement la tête comme si elle voulait nier une évidence.
– J'ai dans mon sac une vieille veste. Et puis, j'ai ramassé le pain dans la cuisine, en partant…
Elle reconnut la voix de son fils. Il avait dû deviner son désarroi.
La nuit, Charlotte s'endormit le temps d'un rêve rapide, mélange de sons et de couleurs d'autrefois… Quelqu'un, en glissant vers la sortie, la réveilla. Le train était arrêté au milieu des champs. L'air nocturne n'avait pas ici la même densité de noir que dans la ville dont ils s'étaient enfuis. La plaine qui s'étendait devant le rectangle pâle de la porte ouverte gardait le teint cendré des nuits du Nord. Quand ses yeux apprivoisèrent l'obscurité, elle distingua à côté de la voie, dans l'ombre d'un bosquet, les contours d'une isba assoupie. Et devant, dans un pré qui longeait le remblai, elle vit un cheval. Le silence était tel qu'on entendait le léger crissement des tiges arrachées et le piétinement mou des sabots sur la terre humide. Avec une sérénité amère qui l'étonna elle-même, Charlotte entendit naître et résonner dans son esprit cette pensée transparente: «Il y a eu cet enfer des villes brûlées et quelques heures plus tard – ce cheval qui broute l'herbe pleine de rosée, dans la fraîcheur de la nuit. Ce pays est trop grand pour qu'ils puissent le vaincre. Le silence de cette plaine infinie résistera à leurs bombes…»
Jamais encore elle ne s'était sentie aussi proche de cette terre.
Pendant les premiers mois de la guerre, son sommeil était traversé par un incessant défilé de corps mutilés qu'elle soignait en travaillant quatorze heures par jour. Dans cette ville, à une centaine de kilomètres de la ligne du front, on amenait les blessés par convois entiers. Souvent, Charlotte accompagnait le médecin qui venait à la gare pour accueillir ces trains remplis de chair humaine écharpée. Il lui arrivait alors de remarquer, sur la voie parallèle, un autre train, plein de soldats fraîchement mobilisés qui partaient dans le sens opposé, se dirigeant vers le front.
La ronde des corps mutilés ne s'interrompait pas même dans son sommeil. Ils traversaient ses rêves, se rassemblaient à la frontière de ses nuits, l'attendaient: ce jeune fantassin à la mâchoire inférieure arrachée et dont la langue pendait sur les pansements sales, cet autre – sans yeux, sans visage… Mais surtout ceux, de plus en plus nombreux, qui avaient perdu bras et jambes – horribles troncs sans membres, regards aveuglés par la douleur et le désespoir.
Oui, c'étaient surtout ces yeux qui déchiraient le voile fragile de ses rêves. Ils formaient des constellations scintillantes dans l'obscurité, la suivaient partout, lui parlaient silencieusement.
Une nuit (des colonnes infinies de chars traversaient la ville), son sommeil fut plus que jamais fragile – une série de brefs oublis et de réveils au milieu du rire métallique des chenilles. C'est sur le fond pâle de l'un de ces songes que Charlotte commença soudain à reconnaître toutes ces constellations des yeux. Oui, elle les avait déjà vues, un jour dans une autre ville. Dans une autre vie. Elle se réveilla, surprise de ne plus entendre le moindre bruit. Les chars avaient quitté la rue. Le silence assourdissait. Et dans cette obscurité compacte et muette, Charlotte revoyait les yeux des blessés de la Grande Guerre. Le temps de l'hôpital de Neuilly se rapprocha soudain. «C'était hier», pensa Charlotte.
Elle se leva et vint à la fenêtre pour fermer un vasistas. Son geste s'arrêta à mi-chemin. La tempête blanche (la première neige de ce premier hiver de guerre) tapissait, à grandes volées, la terre encore noire. Le ciel brassé par les vagues neigeuses aspira son regard dans des profondeurs mouvantes. Elle pensa à la vie des hommes. A leur mort. À la présence quelque part sous ce ciel tumultueux d'êtres sans bras ni jambes, à leurs yeux ouverts dans la nuit.
La vie lui apparut alors comme une monotone suite de guerres, un interminable pansement de plaies toujours ouvertes. Et le fracas de l'acier sur les pavés humides… Elle sentit un flocon se poser sur son bras. Oui, ces guerres sans fin, ces plaies et, dans une attente secrète au milieu d'elles, cet instant de la première neige.
Les regards des blessés s'effacèrent dans ses rêves deux fois seulement pendant la guerre. D'abord quand sa fille tomba malade du typhus, et il fallait trouver coûte que coûte du pain et du lait (ils mangeaient depuis des mois des éplu-chures de pommes de terre). La deuxième fois, lorsqu'elle reçut du front un avis de décès… Arrivée à l'hôpital le matin, elle y resta toute la nuit en espérant être assommée par la fatigue, en craignant de rentrer, de voir les enfants, de devoir leur parler. Vers minuit, elle s'assit enfin près du poêle, la tête contre le mur, ferma les yeux et tout de suite s'engagea dans une rue… Elle entendait la sonorité matinale des trottoirs, respirait l'air éclairé d'un soleil pâle, oblique. En marchant dans cette ville encore endormie, elle reconnaissait à chaque pas sa topographie naïve: café de la gare, église, place du marché… Elle ressentait une joie étrange à lire le nom des rues, à regarder le reflet des fenêtres, le feuillage dans le square derrière l'église. Celui qui marchait à côté d'elle lui demanda de traduire l'un de ces noms. Elle devina alors ce qui rendait si heureuse cette promenade à travers la ville matinale…
Charlotte sortit du sommeil en gardant dans le mouvement des lèvres les dernières paroles prononcées là-bas. Et quand elle comprit toute l'invraisemblance de son rêve – elle et Fiodor dans cette ville française par une matinée claire d'automne -, quand elle pénétra l'irréalité absolue de cette promenade pourtant si simple, elle tira de sa poche un petit rectangle de papier et relut pour la centième fois la mort imprimée en lettres floues et le nom de son mari écrit à la main, à l'encre violette. Quelqu'un l'appelait déjà de l'autre bout du couloir. Le nouveau convoi des blessés allait arriver.
Des «samovars»! C'est ainsi que dans leurs conversations nocturnes, mon père et ses amis appelaient parfois ces soldats sans bras ni jambes, ces troncs vivants dont les yeux concentraient tout le désespoir du monde. Oui, c'étaient des samovars: avec des bouts de cuisses semblables aux pieds de ce récipient en cuivre et des moignons d'épaules, pareils à ses anses.
Nos invités en parlaient avec une drôle de crâ-nerie, moquerie et amertume mélangées. Ce «samovar» ironique et cruel signifiait que la guerre était loin, oubliée par les uns, sans intérêt pour les autres, pour nous, les jeunes nés une dizaine d'années après leur Victoire. Et pour ne pas paraître pathétiques, pensais-je, ils évoquaient le passé avec cette désinvolture un peu canaille, sans croire ni au bon Dieu ni au diable, selon un dicton russe. C'est bien plus tard que ce ton désabusé me révélerait son vrai secret: un «samovar» était une âme happée par un morceau de chair désarticulé, un cerveau détaché du corps, un regard sans force englué dans la pâte spongieuse de la vie. Cette âme meurtrie, les hommes l'appelaient «samovar».
Raconter la vie de Charlotte était pour eux aussi une façon de ne pas étaler leurs propres plaies et leurs souffrances. D'autant plus que son hôpital, en brassant des centaines de soldats venus de tous les fronts, condensait des destins innombrables, accumulait tant d'histoires personnelles.
Ce soldat, par exemple, qui m'impressionnait toujours avec sa jambe farcie de… bois. Un éclat s'incrustant sous son genou avait concassé une cuillère en bois qu'il portait plantée dans la longue tige de sa botte. La blessure était sans gravité, mais il fallait retirer tous les débris. «Toutes ces échardes», selon Charlotte.