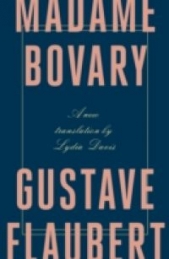Le testament fran?ais

Le testament fran?ais читать книгу онлайн
Ce roman a l’originalit? de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, ? travers les nombreux r?cits que Charlotte Lemonnier, «?gar?e dans l’immensit? neigeuse de la Russie», raconte ? son petit-fils et confident.
Ce roman a re?u le prix Goncourt 1995 et ex-aequo le prix M?dicis 1995.
***
«Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans ga?t?, Charlotte m'avait dit qu'apr?s tous ses voyages ? travers l'immense Russie, venir ? pied jusqu'en France n'aurait pour elle rien d'impossible […]. Au d?but, pendant de longs mois de mis?re et d'errances, mon r?ve fou ressemblerait de pr?s ? cette bravade. J'imaginerais une femme v?tue de noir qui, aux toutes premi?res heures d'une matin?e d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville frontali?re […]. Elle pousserait la porte d'un caf? au coin d'une ?troite place endormie, s'installerait pr?s de la fen?tre, ? c?t? d'un calorif?re. La patronne lui apporterait une tasse de th?. Et en regardant, derri?re la vitre, la face tranquille des maisons ? colombages, la femme murmurerait tout bas: "C'est la France… Je suis retourn?e en France. Apr?s… apr?s toute une vie."»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
D'ailleurs, dans ce pays exotique, le culte de l'amour ne connaissait pas de frontières sociales, et loin de ces boudoirs regorgeant de luxe, dans les faubourgs populaires, nous voyions deux bandes rivales de Belleville s'entre-tuer à cause d'une femme. Seule différence: les cheveux de la belle Otero avaient l'éclat d'une aile de corbeau, tandis que la chevelure de l'amoureuse disputée brillait comme des blés mûrs dans la lumière du couchant. Les bandits de Belleville l'appelaient Casque d'or.
Notre sens critique se révoltait à ce moment-là. Nous étions prêts à croire en l'existence des mangeurs de grenouilles, mais imaginer des gangsters s'égorger pour les beaux yeux d'une femme!
Visiblement, cela n'avait rien d'étonnant pour notre Atlantide: n'avions-nous pas déjà vu l'oncle de Charlotte sortir en titubant du fiacre, l'œil trouble, le bras emmaillote dans un foulard ensanglanté – il venait de se battre en duel, dans la forêt de Marly, en défendant l'honneur d'une dame… Et puis, ce général Boulanger, ce dictateur déchu, ne s'était-il pas brûlé la cervelle sur la tombe de sa bien-aimée?
Un jour, au retour d'une promenade, nous fûmes surpris, tous les trois, par une averse… Nous marchions dans les vieilles rues de Saranza composées uniquement de grandes isbas noircies par l'âge. C'est sous l'auvent de l'une d'elles que nous trouvâmes refuge. La rue, étouffée par la chaleur, il y a une minute, plongea dans un crépuscule froid, balayé par des rafales de grêle. Elle était pavée à l'ancienne – de gros cailloux ronds de granit. La pluie fit monter d'eux une odeur forte de pierre mouillée. La perspective des maisons s'estompa derrière un voile d'eau – et grâce à cette odeur, on pouvait se croire dans une grande ville, le soir, sous une pluie d'automne. La voix de Charlotte, d'abord dépassant à peine le bruit des gouttes, avait l'apparence d'un écho assourdi par les vagues de pluie.
– C'est aussi une pluie qui m'a fait découvrir cette inscription gravée sur le mur humide d'une maison, dans l'allée des Arbalétriers, à Paris. Nous nous étions cachées, ma mère et moi, sous un porche, et en attendant qu'il cesse de pleuvoir, nous n'avions devant nos yeux que cet écusson commémoratif. J'ai appris sa légende par cœur: «Dans ce passage, en sortant de l'hôtel de Barbette, le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, fut assassin é par Jean sans Peur, duc de Bourgogne, dans la nuit du 23 au 24 novembre 1407»… Il sortait de chez la reine Isabeau de Bavière…
Notre grand-mère se tut, mais dans le chuchotement des gouttes nous entendions toujours ces noms fabuleux tissés en un tragique monogramme d'amour et de mort: Louis d'Orléans, Isabeau de Bavière, Jean sans Peur…
Soudain, sans savoir pourquoi, je me souvins du Président. Une pensée très claire, très simple, évidente: c'est que durant toutes ces cérémonies en l'honneur du couple impérial, oui, dans le cortège sur les Champs-Elysées, et devant le tombeau de Napoléon, et à l'Opéra – il n'avait pas cessé de rêver à elle, à sa maîtresse, à Marguerite Steinheil. Il s'adressait au tsar, prononçait des discours, répondait à la tsarine, échangeait un regard avec son épouse. Mais elle, à chaque instant, elle était là.
La pluie ruisselait sur le toit moussu de la vieille isba qui nous abritait sur son perron. J'oubliai où j'étais. La ville que j'avais visitée autrefois en compagnie du tsar se transfigurait à vue d'œil. Je l'observais à présent avec le regard du Président amoureux.
Cette fois, en quittant Saranza, j'avais l'impression de revenir d'une expédition. J'emportais une somme de connaissances, un aperçu des us et des coutumes, une description, encore lacunaire, de la mystérieuse civilisation qui chaque soir renaissait au fond de la steppe.
Tout adolescent est classificateur – réflexe de défense devant la complexité du monde adulte qui l'aspire au seuil de l'enfance. Je l'étais peut-être plus que les autres. Car le pays que j'avais à explorer n'existait plus, et je devais reconstituer la topographie de ses hauts lieux et de ses lieux saints à travers l'épais brouillard du passé.
Je m'enorgueillissais surtout d'une galerie de types humains que je possédais dans ma collection. Outre le Président-amant, les députés dans une barque et le dandy avec sa grappe de raisin, il y avait des personnages bien plus humbles quoique non moins insolites. Ces enfants, par exemple, tout jeunes ouvriers des mines, avec leur sourire cerné de noir. Un crieur de journaux (nous n'osions pas imaginer un fou qui aurait pu courir dans les rues en criant: «La Pravda ! La Pravda! »). Un tondeur de chiens qui exerçait son métier sur les quais. Un garde champêtre avec son tambour. Des grévistes rassemblés autour d'une «soupe communiste». Et même un marchand de crottes de chiens. J'étais très fier de savoir que cette étrange marchandise était utilisée, à l'époque, pour assouplir les cuirs…
Mais ma plus grande initiation, cet été, fut de comprendre comment on pouvait être français. Les innombrables facettes de cette fuyante identité s'étaient composées en un tout vivant. C'était une manière d'exister très ordonnée malgré ses côtés excentriques.
La France n'était plus pour moi un simple cabinet de curiosités, mais un être sensible et dense dont une parcelle avait été un jour greffée en moi.
2
– Non, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a voulu s'enterrer dans cette Saranza. Elle aurait pu très bien vivre ici, à côté de vous…
Je faillis bondir de mon tabouret près du téléviseur. C'est que je comprenais si bien pour quelle raison Charlotte tenait à sa petite ville de province. Il m'eût été si facile d'expliquer son choix aux adultes réunis dans notre cuisine. J'aurais évoqué l'air sec de la grande steppe qui distillait le passé dans sa transparence muette. J'aurais parlé de ces rues poussiéreuses qui ne menaient nulle part en débouchant, toutes, sur la même plaine infinie. De cette ville d'où l'histoire, en décapitant les églises et en arrachant les «surabondances architecturales», avait chassé toute notion de temps. La ville où vivre signifiait revivre sans cesse son passé tout en accomplissant machinalement les gestes quotidiens.
Je ne disais rien. J'avais peur de me voir expulsé de la cuisine. Les adultes, je l'avais remarqué depuis un certain temps, toléraient plus facilement ma présence. Je semblais avoir conquis, à mes quatorze ans, le droit d'assister à leurs conversations tardives. À condition de rester invisible. Ravi de ce changement, je ne voulais surtout pas compromettre un tel privilège.
Le nom de Charlotte revenait durant ces veillées d'hiver aussi souvent qu'autrefois. Oui, comme avant, la vie de ma grand-mère offrait à nos invités une matière à parler qui ménageait l'amour-propre de chacun.
Et puis, cette jeune Française avait l'avantage de concentrer dans son existence les moments cruciaux de l'histoire de notre pays. Elle avait vécu sous le Tsar et survécu aux purges staliniennes, elle avait traversé la guerre et assisté à la chute de tant d'idoles. Sa vie, décalquée sur le siècle le plus sanguinaire de l'empire, acquérait à leurs yeux une dimension épique.
C'était elle, cette Française née à l'autre bout du monde, qui suivait d'un regard vide le vallonnement des sables derrière la porte ouverte du wagon («Mais quel diable l'a entraînée dans ce fichu désert?» s'était exclamé un jour l'ami de mon père, le pilote de guerre). À côté d'elle, immobile lui aussi, se tenait son mari Fiodor. Le souffle s'engouffrant dans le wagon n'apportait aucune fraîcheur malgré la course rapide du train. Ils restèrent un long moment dans cette embrasure de lumière et de chaleur. Le vent ponçait leur front comme du papier de verre. Le soleil brisait la vue en une myriade d'éclats. Mais ils ne bougeaient pas, comme s'ils voulaient qu'un passé pénible s'effaçât par ce frottement et cette brûlure. Ils venaient de quitter Boukhara.
C'était elle qui, après leur retour en Sibérie, passait des heures interminables devant une fenêtre noire, en soufflant de temps en temps sur la couche épaisse du givre pour préserver un petit rond fondu. A travers ce judas aqueux, elle voyait une rue blanche, nocturne. Parfois une voiture glissait lentement, s'approchait de leur maison et, après un moment d'indécision, repartait. Trois heures du matin sonnaient et quelques minutes plus tard, elle entendait le crissement aigu de la neige sur le perron. Elle fermait les yeux un instant, puis allait ouvrir. Son mari rentrait toujours à cette heure-là… Les gens disparaissaient tantôt au travail, tantôt en pleine nuit, chez eux, après le passage d'une voiture noire dans les rues enneigées. Elle était sûre que tant qu'elle l'attendait devant la fenêtre, en soufflant sur le givre, rien ne pouvait lui arriver. À trois heures, il se levait, rangeait les dossiers sur son bureau, s'en allait. Comme tous les autres fonctionnaires à travers l'immense empire. Ils savaient qu'au Kremlin, le maître du pays terminait sa journée de travail à trois heures. Sans réfléchir, tout le monde s'empressait d'imiter son emploi du temps. Et on ne pensait même pas que de Moscou à la Sibérie, en enjambant plusieurs fuseaux horaires, ces «trois heures du matin» ne correspondaient plus à rien. Et que Staline se levait de son lit et bourrait la première pipe de la journée, tandis que dans une ville sibérienne, à la nuit tombante, ses sujets fidèles luttaient contre le sommeil sur leurs chaises qui se transformaient en instruments de torture. Du Kremlin, le maître semblait imposer sa mesure au flux du temps et au soleil même. Quand il allait se coucher, toutes les horloges de la planète indiquaient trois heures du matin. Du moins, tout le monde le voyait ainsi à l'époque. Un jour, Charlotte, épuisée par ces attentes nocturnes, s'endormit quelques minutes avant cette heure planétaire. Un instant après, se réveillant en sursaut, elle entendit les pas de son mari dans la chambre d'enfant. Elle y entra et le vit incliné au-dessus du lit de leur fils, de ce garçon aux cheveux noirs et lisses qui ne ressemblait à personne dans la famille…
On arrêta Fiodor non pas dans son bureau en plein jour, ni au petit matin en rompant son sommeil d'un tambourinement autoritaire contre la porte. Non, c'était le soir du réveillon. Il s'était affublé du manteau rouge du Père Noël et, méconnaissable sous une longue barbe, son visage fascinait les enfants: ce garçon de douze ans et sa sœur cadette – ma mère. Charlotte ajustait la grande chapka sur la tête de son mari, lorsqu'ils pénétrèrent dans l'appartement. Ils entrèrent sans avoir à frapper, la porte était ouverte, on attendait les invités.