La mort de Juve (Смерть Жюва)
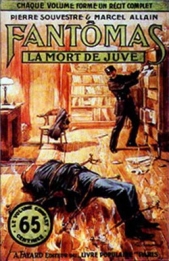
La mort de Juve (Смерть Жюва) читать книгу онлайн
продолжение серии книг про Фантомаса
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
PIERRE SOUVESTRE
ET MARCEL ALLAIN
LA MORT
DE JUVE
14
Arthème Fayard
1912
Cercle du Bibliophile
1970-1972
1 – UN MYSTÉRIEUX SOUPIR
— Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce que vous voulez ? Où suis-je ?
— Mais, monsieur, il est simplement sept heures du matin et c’est moi, Baptiste, qui frappe à la porte de monsieur.
— Oui, Baptiste. Préparez mon tub et dites-moi le temps qu’il fait.
— Il fait froid. Monsieur pourra se couvrir, ce matin. Il pleut également, les rues sont toutes sales.
— Zut, sale métier !
Le valet de chambre s’était retiré, son maître passait dans le cabinet de toilette. C’était un homme d’une quarantaine d’années environ, portant son âge et dont la robuste carrure s’empâtait d’un léger embonpoint. M. Hervé Martel exerçait à Paris la rude mais lucrative profession de courtier-juré d’assurances maritimes. Hervé Martel, depuis sept ou huit ans qu’il en était titulaire, avait fait de sa charge la plus importante de Paris. Mais ce n’était ni sans peine ni sans travail.
Or, au fond de son âme, Hervé Martel était foncièrement paresseux et chaque fois qu’il en trouvait l’occasion, il tirait au flanc à la manière du plus subtil des militaires. Il ne « tirait au flanc » que lorsqu’il n’y avait pas inconvénient à le faire, car, d’autre part, il avait, avec la quarantaine, acquis assez de raison pour se rendre compte que ses efforts étaient couronnés de succès. N’empêche, se lever de bonne heure…
Célibataire endurci, Parisien de bonne race, Hervé Martel appréciait tout particulièrement l’existence de la capitale, le charme des soirées au théâtre, prolongées par quelques heures de causerie au cercle ou dans les restaurants à la mode. Il parvenait difficilement à se coucher avant deux ou trois heures du matin, éprouvait une difficulté insurmontable à répondre aux appels pressants, dès sept heures, été comme hiver, de son domestique tambourinant à la porte.
Ce matin-là, Hervé Martel était encore plus mal éveillé qu’à l’ordinaire. Le temps froid et pluvieux n’invitait guère aux courses et aux promenades, même en voiture.
— Si seulement j’avais mon auto, grommela le courtier maritime, avec ses sacrés chevaux on n’en finit pas.
Depuis quelques jours, en effet, Hervé Martel avait passé commande d’une rapide et élégante berline à moteur et c’est avec impatience que le riche courtier en attendait la livraison.
À la Bourse et dans son milieu de gens d’affaires, on ne parlait de rien d’autre. Déjà, Hervé Martel, ami du progrès, avait remplacé par une machine à écrire et une dactylographe, l’écriture à la plume sergent-major.
Un coup discret frappé à la porte de son cabinet de toilette tira Hervé Martel de ses réflexions. C’était Baptiste.
— C’est le cocher, dit-il, Prosper désire voir monsieur.
— Prosper, mais comment est-il monté ? Il laisse le cheval seul dans la rue ?
— Monsieur, Prosper n’est pas venu avec la voiture de monsieur. Il dit qu’il doit parler à monsieur, que monsieur est au courant.
— Je ne comprends pas. Qu’il entre.
Prosper ne paraissait pas, comme on pouvait s’y attendre, revêtu de sa livrée verte à liseré rouge et coiffé du luisant haut-de-forme à cocarde, caractéristique du cocher de grande maison. Prosper était en civil.
— Eh bien, Prosper, à quoi pensez-vous ? Je pars dans dix minutes.
Le cocher salua :
— Monsieur m’excusera de lui répondre, mais Monsieur a sans doute oublié que depuis ce matin je ne suis plus au service de Monsieur.
— Qu’est-ce que cela signifie, Prosper ?
— Monsieur se souvient que lundi dernier j’ai donné à monsieur mes huit jours. Or, ma semaine est terminée depuis hier soir, et je viens faire mes adieux à Monsieur.
— Mais vous êtes fou, Prosper. Oui, je me souviens, en effet, mais comme il vous est arrivé plusieurs fois de vouloir vous en aller et que vous êtes resté, je n’y ai pas fait attention.
— Aujourd’hui, monsieur, c’est définitif.
— Ah, fit Hervé Martel interloqué. Et peut-on savoir pourquoi ?
— C’est très facile, monsieur. Monsieur va comprendre. Quand je suis entré chez Monsieur, c’est en qualité de cocher. C’est-à-dire pour soigner et conduire le cheval de Monsieur. Or, voilà que Monsieur change d’avis et ne veut plus garder d’attelage. Monsieur a commandé une automobile qui va lui être livrée dans quelques jours, et monsieur m’a dit : « Prosper, vous apprendrez à piloter ces machines-là et vous serez mon mécanicien. » Eh bien, je réponds à Monsieur : je regrette infiniment, mais je n’apprendrai pas à piloter ces machines-là, cocher je suis, cocher je reste.
— Mais vous êtes stupide, mon brave garçon, comprenez donc que plus nous allons, plus votre métier menace de disparaître. Tous les cochers deviennent chauffeurs, c’est connu.
— S’il ne reste qu’un cocher, Monsieur, je serai celui-là.
— Après tout, c’est votre affaire. Allez vous faire régler au bureau. Je vais téléphoner des ordres au fondé de pouvoirs.
— Et le certificat ?
— Eh bien, vous viendrez le reprendre ici un peu plus tard, quand je serai habillé.
Le cocher disparut. Hervé Martel acheva sa toilette, mais soudain son front se plissa : il venait de passer dans la salle à manger pour prendre son déjeuner du matin et considérait, navré, la pluie tombant au dehors, une pluie abondante, qui transformait les rues en cloaques.
— C’est bien ma veine, grommela-t-il, pour un jour que je n’ai pas de voiture, il fait un temps de chien.
Et Hervé Martel lançait à son appartement bien clos, bien confortable, un coup d’œil de regret. Mais, soudain, une pensée lui traversa l’esprit.
Hervé Martel prit le téléphone, demanda la communication avec son bureau de la place de la Bourse.
— C’est vous, monsieur Albert ?
Le courtier maritime donna ses instructions au fondé de pouvoirs, s’enquit du courrier. Au fur et à mesure, son visage se rassérénait.
— N’est-ce pas, monsieur Albert, vous êtes aussi d’avis qu’il est inutile que je passe au bureau, ce matin ? Cela m’arrange parfaitement, d’autant que je suis légèrement enrhumé. Pour les affaires urgentes, eh bien, faites donc une chose : envoyez-moi M lle Hélène, elle prendra mon courrier. Oui, entendu, je l’attends. À tout à l’heure.
Hervé Martel, très satisfait de l’idée qu’il venait d’avoir, avait achevé tranquillement son déjeuner. Puis il était allé s’installer dans son cabinet de travail, pièce élégante décorée avec un goût extrême, remplie d’objets d’art, de tableaux de maîtres, un vrai boudoir. Il est vrai que ce cabinet de travail ne servait guère. Avenue Niel, ce n’était pas le courtier-juré d’assurances que l’on voyait, mais l’homme du monde, le Parisien riche. Hervé Martel, dès qu’il rentrait, à six heures, quittait la jaquette des visites commerciales aussitôt remplacée par le smoking ou l’habit de l’élégant cercleux.
Au bout d’une heure, Baptiste annonça :
— Monsieur, c’est la demoiselle qui est là.
— Priez-la donc d’entrer.
Quelques instants après, dans le cabinet du courtier maritime, pénétrait une jeune fille à la mise à la fois élégante et correcte. Elle retira son manteau, puis, sur l’invitation d’Hervé Martel, elle s’assit à une petite table, à côté d’un vaste bureau qui disparaissait sous les papiers.
Sans hâte, elle défit un rouleau de papier blanc qu’elle avait apporté, puis, de la lame d’un élégant petit canif, elle tailla son crayon.
— Vous y êtes, Mademoiselle Hélène ? demanda M. Martel.
— Oui, Monsieur, répondit la jeune fille. Vous permettez un instant ?





















