La mort de Juve (Смерть Жюва)
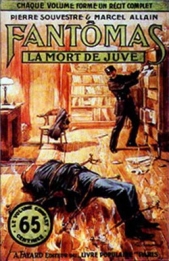
La mort de Juve (Смерть Жюва) читать книгу онлайн
продолжение серии книг про Фантомаса
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Cela te va bien de faire l’imbécile sur mon bureau, hurla-t-il, descends donc, sapristi, remue-toi, aide-moi à chercher. Il n’y a pas de quoi rire, que diable.
Maurice de Cheviron descendit :
— Si, il y a de quoi rire, car enfin, mon vieux, étant donné que nous étions seuls dans la pièce, il faut bien admettre que tes billets n’ont pas pu disparaître. Donc, toute cette affaire n’est pas grave, ne peut pas être grave. Tu vas retrouver ton argent.
— Je ne sais pas si je retrouverai mes billets, criait-il, se traînant à genoux sur le tapis, pour regarder encore sous les meubles, mais en attendant, je ne les retrouve pas et je te préviens, Maurice, que si c’est toi qui les as cachés pour me faire une farce, je trouve cela de très mauvais goût. Voyons, Maurice, criait le courtier, en voilà assez, n’est-ce pas ? C’est drôle pendant cinq minutes, mais ça finit par ne plus être drôle du tout. C’est toi qui as pris ces billets ? dis-le, nom d’un chien !
Doucement, Maurice de Cheviron se dégageait :
— Tu es fou, tu es absolument fou, ma parole, pourquoi veux-tu que je t’aie fait une plaisanterie de cette nature ? Je ne comprends même pas que tu y penses, et en tout cas, puisque je te dis que je n’ai pas ton argent, c’est que je ne l’ai pas. Tu ne devrais pas insister.
L’agent de change, malheureusement, eut beau protester, il ne put convaincre le courtier. Hervé Martel, au point de colère où il était arrivé, n’était plus en état, évidemment, d’apprécier sainement les choses.
— Alors, si ce n’est pas une plaisanterie, dit-il, furieux, c’est un vol.
— Tu m’accuses, ma parole.
— Non, je ne t’accuse pas, mais enfin. Enfin, tu constates toi-même que nous venons de fouiller de fond en comble tout mon cabinet de travail, les billets y étaient. Ils n’y sont plus. Donc, forcément, fatalement, ils sont sur l’un de nous, toi ou moi.
— Comme ce n’est pas moi qui les ai pris.
— Eh oui, c’est stupide à la fin cette aventure. Tu viens de dire des absurdités, mais, en effet, il y a quelque chose de sûr. Les billets ne sont pas dans la pièce, à moins d’être sur nous. Il n’y a que nous, qui ne nous soyons pas fouillés, eh bien, finissons-en, retournons nos poches.
Maurice de Cheviron paya d’exemple. En un tournemain, avec une rapidité qui était un peu fébrile, il se dépouilla de sa veste, dont il vida les poches, avec un soin extrême, il la secoua, il l’agita. Les billets ne tombèrent pas du vêtement.
— Nous allons bien voir dans le pantalon.
De plus en plus énervé, l’agent de change se dépouilla de son pantalon, le secoua en tous sens, en retourna les poches. Sans plus de résultat.
— Es-tu convaincu ?
Hervé Martel haussa les épaules :
— Tu vas voir que je ne les ai pas non plus, fit-il. À son tour, il se déshabilla. En caleçon, en chemise,
les deux amis se regardèrent.
— C’est tout de même fort, commença Maurice de Cheviron, mais j’en aurai le cœur net, que diable.
Il déboutonna son faux-col, se dévêtit complètement :
— Là, maintenant, je pense qu’il est bien prouvé que les cent mille francs ne sont pas sur moi.
Hervé Martel l’avait imité :
— Ni sur moi.
Or, tandis qu’ils étaient ainsi déshabillés, un coup discret fut frappé à la porte du cabinet de travail.
— Entrez, cria Hervé, machinalement.
Le visiteur poussa la porte, la visiteuse plutôt, car c’était Rosalie, la vieille bonne qui venait avertir son patron que l’automobile l’attendait.
Ayant vu les deux hommes en petite tenue, Rosalie partit au galop dans le corridor, criant :
— Ils sont devenus fous. Ce sont des satyres. Au secours, au secours !
6 – L’INSAISISSABLE APPARAÎT
Ce n’était pas encore le grand luxe, le luxe des banques fastueuses où les clients sont invités à s’asseoir sur de vastes et moelleux fauteuils de cuir, mais tout de même le contentieux avait gagné en confortable, progressé en luxe et son aménagement faisait le constant orgueil de Pérouzin et de Nalorgne.
La veille même, les deux associés s’étaient rendus aux « Magasins Réunis » et y avaient fait l’acquisition d’un certain nombre d’objets de première utilité. Une corbeille à papier monumentale remplaçait l’antique carton à chapeau qui jusqu’alors en avait tenu lieu, des chaises neuves s’alignaient le long du mur, deux fauteuils de bureau tendaient des bras accueillants au milieu de la pièce, une lampe de cuivre, étincelante, trônait en bonne place sur la table de Nalorgne.
À cette table, Pérouzin était assis. Il brandissait un superbe crayon bleu, acquisition de la veille, et il alignait des chiffres, cependant que Nalorgne, penché sur son épaule, surveillait anxieusement son travail.
— Combien trouvez-vous, Pérouzin ?
— Huit et huit seize et trois dix-neuf, et six, vingt-cinq, je pose cinq et je retiens deux. Mon cher ami, nous avons fait ce mois-ci, huit mille sept cents francs. C’est trop beau. Ça ne durera pas.
— Pérouzin, vous êtes assommant avec votre pessimisme qui ne vous empêche pas d’engraisser. Pourquoi voulez-vous que ça ne dure pas ? La combinaison est merveilleuse, simple, sans aléas, elle n’expose presque pas à des risques, et de plus elle promet de rapporter gros, toujours plus gros. Tenez, je donnerai ma tête à couper que nous ferons cinquante mille cette année. Cinquante mille francs, vous m’entendez ? nous ferons cinquante mille francs.
— Ou vingt mois de prison.
— Pérouzin, vous êtes assommant. Vous voyez toujours tout en noir, vous mettez tout au pis. Ah, tenez, vous mériteriez, en vérité, que tout à l’heure je répète vos paroles à Prosper, à notre excellent ami Prosper, à notre cher associé.
Cela s’était fait tout doucement.
Petit à petit, gagnés à la tranquille inconscience de Prosper, Pérouzin et Nalorgne s’étaient trouvés associés avec l’escroc.
Les séduisants sourires d’Irma de Steinkerque, maîtresse admirée de Prosper, n’avaient peut-être pas été d’ailleurs pour peu de chose dans l’extraordinaire changement qui s’était fait dans l’attitude des deux hommes d’affaires passant du rôle de policiers à celui de complices, d’escrocs. À vrai dire, Nalorgne et Pérouzin, depuis qu’ils aidaient Prosper à réaliser ce que celui-ci appelait ses petits bénéfices, n’avaient guère lieu de se plaindre. L’association donnait les meilleurs résultats. Pérouzin, qui geignait toujours, s’était révélé comme un dessinateur de première force, il n’avait pas son pareil pour dessiner un acte, car il n’entendait pas qu’on dise, cela le vexait, qu’il imitait les signatures. Nalorgne, de son côté, ne restait pas inactif. Peut-être avait-il trouvé sa voie, il faisait preuve d’une merveilleuse ingéniosité pour obtenir des renseignements sur les mouvements de caisse des grandes maisons de commerce de Paris. Prosper, jadis n’opérait que les jours d’échéance, maintenant, grâce aux secours qu’il recevait de Nalorgne et Pérouzin, il ne s’écoulait guère de journées sans que, muni de factures dûment acquittées, il ne parvînt à se faire remettre des fonds.
— Nalorgne, je ne sais pourquoi mais j’imagine que demain, oui demain, nous connaîtrons notre Waterloo.
— Taisez-vous donc, mon cher. Je pense au soleil d’Austerlitz.
L’arrivée de Prosper, coupa court à ces métaphores guerrières. Prosper, joyeux, comme à son ordinaire, la figure épanouie, le geste large et la voix tonitruante :
— Hé, alors, les enfants, criait l’ancien cocher, serrant les mains de Nalorgne et Pérouzin, comment ça va la petite santé ? pas mal hein ? Vous avez embelli votre logement, des chaises neuves, une lampe, une corbeille à papiers. Sapristi de sapristi, c’est pas du fumier de moineaux.
Nalorgne et Pérouzin, cependant, avaient été chercher des verres, puis une vieille bouteille de fine que l’ancien cocher aimait à accoler.
Prosper, d’ailleurs, ne perdit pas son temps en circonlocutions :





















