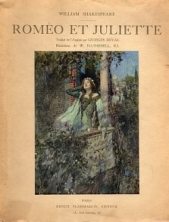La premiere gorgee de biere et autres plaisirs minuscules

La premiere gorgee de biere et autres plaisirs minuscules читать книгу онлайн
On dit que la vie n'est pas simple et que le bonheur est rare. Pour Philippe Delerm, il tient en trente-quatre "plaisirs minuscules". Il ?voque ici tour ? tour, sous forme de petites s?quences, la satisfaction immense qu'il tire tant?t de petits gestes insignifiants, tant?t d'une bienheureuse absence de gestes. Toutes les saisons sont ?voqu?es dans ce petit ouvrage d?licieux qui s'apparente presque ? un manuel du bonheur ? l'usage des gens trop press?s. Les plaisirs de la table y ont une place privil?gi?e et, tout comme les plaisirs d'un autre ordre, font ressurgir avec humour et nostalgie l'univers de l'enfance, chez le narrateur comme chez le lecteur, rendus complices par la merveilleuse banalit? des situations d?crites. Gr?ce ? ce trait? de vie simple, Delerm nous rappelle que prendre le temps, socialement ou ? part soi, n'est pas une perte de temps. Certaines s?quences sont toutefois ambigu?s, comme celle sur Le Dimanche soir. S'ouvrant sur la description d'une joie, elles s'ach?vent avec gravit? sur une sensation douloureuse, comme pour nous rappeler que le bonheur, s'il n'est pas rare, est tout de m?me pr?cieux.
«C’est facile, d’?cosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s’ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins m?res, sont plus r?ticentes – une incision de l’ongle de l’index permet alors de d?chirer le vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau faussement parchemin?e. Apr?s, on fait glisser les boules d’un seul doigt. La derni?re est si minuscule… L’?cossage des petits pois n’est pas con?u pour expliquer, mais pour suivre le cours, ? l?ger contretemps. Il y en aurait pour cinq minutes mais c’est bien de prolonger, d’alentir le matin, gousse ? gousse, manches retrouss?es. On passe les mains dans les boules ?coss?es qui remplissent le saladier. C’est doux; toutes ces rondeurs contigu?s font comme une eau vert tendre, et l’on s’?tonne de ne pas avoir les mains mouill?es. Un long silence de bien-?tre clair, et puis il y aura juste le pain ? aller chercher.»
«Mise en sc?ne avec humour par France Jolly, sept com?diens fort sympathiques nous font partager des instants qui valent moins que rien, mais comptent plus que tout»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
C'est juste à ce moment-là qu'on relève la tête. Les premiers mots viennent avec une banalité exquise, un faux détachement – «oui, c'est moi – oui, ça s'est bien passé – je suis juste à côté du petit café, tu sais, place Saint-Sulpice».
Ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, mais ce qu'on entend. C'est fou comme la voix seule peut dire d'une personne qu'on aime – de sa tristesse, de sa fatigue, de sa fragilité, de son intensité à vivre, de sa joie. Sans les gestes, c'est la pudeur qui disparaît, la transparence qui s'installe. Au-dessus du bloc téléphonique bêtement gris s'éveille alors une autre transparence. On voit soudain le trorroir devant soi, et le kiosque à journaux, les gosses qui patinent. Cette façon d’accueillir tout à coup l'au-delà de la vitre est très douce et magique: c'est comme si le paysage naissait avec la voix lointaine. Un sourire vient aux lèvres. La cabine se fait légère, et n'est plus que de verre. La voix si près si loin vous dit que Paris n'est plus un exil, que les pigeons s'envolent sur les bancs, que l'acier a perdu.
La bicyclette et le vélo
C'est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée mauve fluo dévale à soixante-dix à l'heure: c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges: c'est de la bicyclette. L'écart peut se réduire. Michel Audiard en knickers et chaussettes hautes s'arrête pour boire un blanc sec au comptoir d'un bistro: c'est du vélo. Un adolescent en jeans descend de sa monture, un bouquin à la main, et prend une menthe à l'eau à la terrasse: c'est de la bicyclette. On est d'un camp ou bien de l'autre. Il y a une frontière. Les lourds routiers ont beau jouer du guidon recourbé: c'est de la bicyclette. Les demi-course ont beau fourbir leurs garde-boue: c'est du vélo. Il vaut mieux ne pas feindre, et assumer sa race. On porte au fond de soi la perfection noire d'une bicyclette hollandaise, une écharpe flottant sur l'épaule. Ou bien on rêve d'un vélo de course si léger: le bruissement de la chaîne glisserait comme un vol d'abeille. À bicyclette, on est un piéton en puissance, flâneur de venelles, dégustateur du journal sur un banc. À vélo, on ne s'arrête pas: moulé jusqu'aux genoux dans une combinaison néospatiale, on ne pourrait marcher qu'en canard, et on ne marche pas.
C'est la lenteur et la vitesse? Peut-être. Il y a pourtant des moulineurs à bicyclette très efficaces, et des petits pépés à vélo bien tranquilles. Alors, lourdeur contre légèreté? Davantage. Rêve d'envol d'un côté, de l'autre familiarité appuyée avec le sol. Et puis… Opposition de tout. Les couleurs. Au vélo l'orange métallisé, le vert pomme granny, et pour la bicyclette le marron terne, le blanc cassé, le rouge mât. Matières et formes aussi. À qui l'ampleur, la laine, le velours, les jupes écossaises? À l'autre l'ajusté dans tous les synthétiques.
On naît bicyclette ou vélo, c'est presque politique. Mais les vélos doivent renoncer à cette part d'eux-mêmes pour aimer – car on n'est amoureux qu'à bicyclette.
La pétanque des néophytes
– Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tires, ou tu pouinntes?
Cette mauvaise imitation de l'accent marseillais fait partie des usages. On se sent un peu gourd, les boules à la main. On a beau parodier pour se donner du cœur au ventre, se promettre le pastis ou la Fanny, contrefaire le Raimu furibard, le Fernandel goguenard, on le sent bien: il faut se résigner au deuxième degré, car on n'a pas le style. Non, pas cet accroupissement confortable du premier pointeur, les genoux écartés, méditant le-bon-che-min en faisant tressauter la boule dans sa main recroquevillée. Pas ce silence qui précède les hautes œuvres du tireur – et dans l'exaspération de son attente, il y a comme un risque provocateur, méticuleusement consommé. D'ailleurs, on ne joue pas à la pétanque, mais aux boules: pour un têtard-surprise, un carreau stupéfiant, combien d'approches molles à un mètre du cochonnet, de tirs kamikazes enlevant la boule qu'on ne visait pas!
Il n'empêche. On a ce bruit de fête; ce bruit d'été des boules claires entrechoquées. On retrouve des phrases, on retrouve des gestes.
– Tu le vois, toi?
Alors on s'approche, on désigne du bout du soulier «le petit», caché entre deux cailloux blancs. Peu à peu, les phrases s'espacent, on ose se concentrer davantage. Au lieu d'attendre son tour à côté du cercle, on va se placer au cœur de l'action, près des boules déjà jouées.
– Elle a pris?
On ramasse un bout de ficelle. Tout le monde s'approche. On mesure, et c'est très difficile de ne rien déplacer, sous le regard dubitatif des adversaires.
– Oui, elle tient. Oh, il n'y a pas des kilomètres!
On revient jouer la dernière à petits pas faussement nonchalants. On n'aura pas la cuistrerie de s'agenouiller, mais celle-là on la joue lente, retenue, presque cérémonieuse. Quelques secondes, on la regarde choisir son chemin. Pendant la fin de sa course, on se rapproche, avec un petit signe de dénégation où perce une légère fausse modestie. Elle ne prendra pas, mais elle est bien au jeu, et l'on n'a pas failli.
Au début de la partie, on ramassait les boules des autres, à l'occasion. Mais maintenant, on y est. On ramasse les siennes.