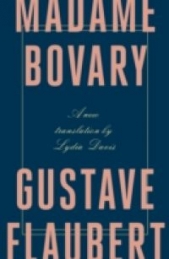Le testament fran?ais

Le testament fran?ais читать книгу онлайн
Ce roman a l’originalit? de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, ? travers les nombreux r?cits que Charlotte Lemonnier, «?gar?e dans l’immensit? neigeuse de la Russie», raconte ? son petit-fils et confident.
Ce roman a re?u le prix Goncourt 1995 et ex-aequo le prix M?dicis 1995.
***
«Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans ga?t?, Charlotte m'avait dit qu'apr?s tous ses voyages ? travers l'immense Russie, venir ? pied jusqu'en France n'aurait pour elle rien d'impossible […]. Au d?but, pendant de longs mois de mis?re et d'errances, mon r?ve fou ressemblerait de pr?s ? cette bravade. J'imaginerais une femme v?tue de noir qui, aux toutes premi?res heures d'une matin?e d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville frontali?re […]. Elle pousserait la porte d'un caf? au coin d'une ?troite place endormie, s'installerait pr?s de la fen?tre, ? c?t? d'un calorif?re. La patronne lui apporterait une tasse de th?. Et en regardant, derri?re la vitre, la face tranquille des maisons ? colombages, la femme murmurerait tout bas: "C'est la France… Je suis retourn?e en France. Apr?s… apr?s toute une vie."»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Un jour, voulant dire à Charlotte quelque chose d'autre qu'un simple bonjour, il toussota dans son gros poing et bougonna:
– Comme ça, Charlota Norbertovna, vous êtes toute seule ici, dans nos steppes…
C'est grâce à cette réplique maladroite que je pouvais imaginer (ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors) ma grand-mère sans nous, en hiver, seule dans sa chambre.
À Moscou ou à Leningrad tout se serait passé autrement. La bigarrure humaine de la grande ville eût effacé la différence de Charlotte. Mais elle s'était retrouvée dans cette petite Saranza, idéale pour vivre des journées semblables les unes aux autres. Sa vie passée demeurait intensément présente, comme vécue d'hier.
Telle était Saranza: figée à la bordure des steppes dans un étonnement profond devant l'infini qui s'ouvrait à ses portes. Des rues courbes, poussiéreuses, qui ne cessaient de monter sur les collines, des haies en bois sous la verdure des jardins. Soleil, perspectives ensommeillées. Et des passants qui, surgissant au bout d'une rue, semblaient avancer éternellement sans jamais arriver à votre hauteur.
La maison de ma grand-mère se trouvait à la limite de la ville dans le lieu-dit «la Clairière d'Ouest»: une telle coïncidence (Ouest-Europe-France) nous amusait beaucoup. Cet immeuble de trois étages construit dans les années dix devait inaugurer, selon le projet d'un gouverneur ambitieux, toute une avenue portant l'empreinte du style moderne. Oui, l'immeuble était une réplique lointaine de cette mode du début du siècle. On aurait dit que toutes les sinuosités, galbes et courbes de cette architecture avaient ruisselé en découlant de sa source européenne et, affaiblies, à moitié effacées, étaient parvenues jusqu'aux profondeurs de la Russie. Et sous le vent glacé des steppes, ce ruissellement s'était figé en un immeuble aux étranges œils-de-bœuf ovales, aux tiges de rosiers décoratifs entourant les entrées… Le projet du gouverneur éclairé avait échoué. La révolution d'Octobre coupa court à toutes ces tendances décadentes de l'art bourgeois. Et cet immeuble – une tranche étroite de l'avenue rêvée – était resté unique en son genre. D'ailleurs, après maintes réparations, il ne gardait que l'ombre de son style initial. C'est surtout la campagne officielle de lutte «contre les surabondances architecturales» (dont, tout jeunes enfants, nous avions été témoins) qui lui avait porté le coup fatal. Tout paraissait «surabondant»: les ouvriers avaient arraché les tiges de rosiers, condamné les œils-de-bœuf… Et comme il se trouve toujours des personnes qui veulent faire du zèle (c'est grâce à elles que les campagnes réussissent vraiment), le voisin du dessous s'était évertué à détacher du mur le surplus architectural le plus flagrant: deux visages de jolies bacchantes qui se souriaient mélancoliquement de part et d'autre du balcon de notre grand-mère. Il avait dû, pour y parvenir, accomplir des prouesses très risquées, dressé sur le rebord de sa fenêtre, un long outil d'acier à la main. Les deux visages, l'un après l'autre, s'étaient décollés du mur et étaient tombés à terre. L'un d'eux s'était brisé en mille fragments sur l'asphalte, l'autre, suivant une trajectoire différente, avait plongé dans la végétation touffue des dahlias, amortissant sa chute. À la tombée de la nuit, nous l'avions récupéré et transporté chez nous. Désormais, durant nos longues soirées d'été sur le balcon, ce visage de pierre avec son sourire flétri et ses yeux tendres nous regardait au milieu des pots de fleurs et semblait écouter les récits de Charlotte.
De l'autre côté de la cour recouverte du feuillage des tilleuls et des peupliers se dressait une grande maison en bois de deux étages, toute noire du temps, aux petites fenêtres sombres et soupçonneuses. C'est elle et ses semblables que le gouverneur voulait effacer par la gracieuse clarté du style moderne. Dans cette construction, vieille de deux siècles, habitaient les babouchkas les plus folkloriques, directement sorties des contes – avec leurs châles épais, leurs visages mortellement blêmes, leurs mains osseuses, presque bleues, gisant sur les genoux. Quand il nous arrivait de pénétrer dans cette demeure obscure, j'étais toujours pris à la gorge par l'odeur âpre, lourde, mais pas tout à fait désagréable qui stagnait dans les couloirs encombrés. C'était celle de la vie ancienne, ténébreuse et très primitive dans sa façon d'accueillir la mort, la naissance, l'amour, la douleur. Une sorte de climat pesant, mais plein d'une étrange vitalité, en tout cas le seul qui puisse convenir aux habitants de cette énorme isba. Le souffle russe… À l'intérieur, nous étions étonnés par le nombre et la dissymétrie des portes qui s'ouvraient sur des pièces plongées dans une ombre fumeuse. Je sentais, presque physiquement, la densité charnelle des vies qui s'entremêlaient ici. Gavrilytch vivait dans la cave que partageaient avec lui trois familles. L'étroite fenêtre de sa chambre se situait au ras du sol et, dès le printemps, elle était obstruée d'herbes folles. Les babouchkas, assises sur leur banc, à quelques mètres de là, jetaient de temps en temps des coups d'ceil inquiets – il n'était pas rare de voir entre ces tiges, dans la fenêtre ouverte, la large face du «scandaliste». Sa tête semblait sortir de la terre. Mais à ces instants de contemplation, Gavrilytch restait toujours calme. Il renversait le visage comme s'il voulait apercevoir le ciel et l'éclat du couchant dans les branches des peupliers… Un jour, parvenant jusqu'au grenier de cette grande isba noire, sous son toit chauffé par le soleil, nous poussâmes le lourd abattant d'une faîtière. À l'horizon, un terrifiant incendie embrasait la steppe, la fumée allait bientôt éclipser le soleil…
La révolution n'avait réussi en fin de compte qu'une seule innovation dans ce coin calme de Saranza. L'église, située à l'une des extrémités de la cour, s'était vu enlever sa coupole. On avait également retiré l'iconostase et installé à sa place un grand carré de soie blanche – l'écran, confectionné avec les rideaux réquisitionnés dans l'un des appartements bourgeois de l'immeuble «décadent». Le cinéma La Barricade était prêt à accueillir ses premiers spectateurs…
Oui, notre grand-mère était cette femme qui pouvait parler tranquillement avec Gavrilytch, la femme qui s'opposait à toutes les campagnes et qui, un jour, nous avait dit avec un clin d'œil, en parlant de notre cinéma: «Cette église décapitée…» Et nous avions vu s'élever au-dessus de la bâtisse trapue (dont le passé nous était inconnu), la silhouette élancée d'un bulbe doré et d'une croix.
Bien plus que ses habits ou son physique, c'étaient ces petits signes qui nous révélaient sa différence. Quant au français, nous le considérions plutôt comme notre dialecte familial. Après tout, chaque famille a ses petites manies verbales, ses tics langagiers et ses surnoms qui ne traversent jamais le seuil de la maison, son argot intime.
L'image de notre grand-mère était tissée de ces anodines étrangetés – originalité aux yeux de certains, extravagances pour les autres. Jusqu'au jour où nous découvrîmes qu'un petit caillou couvert de rouille pouvait faire perler des larmes sur ses cils et que le français, notre patois domestique, pouvait – par la magie de ses sons – arracher aux eaux noires et tumultueuses une ville fantasmatique qui revenait lentement à la vie.
D'une dame aux obscures origines non russes, Charlotte se transforma, ce soir-là, en messagère de l'Atlantide engloutie par le temps.
3
Neuilly-sur-Seine était composée d'une douzaine de maisons en rondins. De vraies isbas avec des toits recouverts de minces lattes argentées par les intempéries d'hiver, avec des fenêtres dans des cadres en bois joliment ciselés, des haies sur lesquelles séchait le linge. Les jeunes femmes portaient sur une palanche des seaux pleins qui laissaient tomber quelques gouttes sur la poussière de la grand-rue. Les hommes chargeaient de lourds sacs de blé sur une télègue. Un troupeau, dans une lenteur paresseuse, coulait vers l'étable. Nous entendions le son sourd des clochettes, le chant enroué d'un coq. La senteur agréable d'un feu de bois – l'odeur du dîner tout proche – planait dans l'air.
Car notre grand-mère nous avait bien dit, un jour, en parlant de sa ville natale:
– Oh! Neuilly, à l'époque, était un simple village…
Elle l'avait dit en français, mais nous, nous ne connaissions que les villages russes. Et le village en Russie est nécessairement un chapelet d'isbas – le mot même dérevnia vient de dérévo - l'arbre, le bois. La confusion fut tenace malgré les éclaircissements que les récits de Charlotte apporteraient par la suite. Au nom de «Neuilly», c'est le village avec ses maisons en bois, son troupeau et son coq qui surgissait tout de suite. Et quand, l'été suivant, Charlotte nous parla pour la première fois d'un certain Marcel Proust, «à propos, on le voyait jouer au tennis à Neuilly, sur le boulevard Bureau», nous imaginâmes ce dandy aux grands yeux langoureux (elle nous avait montré sa photo) – au milieu des isbas!
La réalité russe transparaissait souvent sous la fragile patine de nos vocables français. Le président de la République n'échappait pas à quelque chose de stalinien dans le portrait que brossait notre imagination. Neuilly se peuplait de kolkhoziens. Et Paris qui se libérait lentement des eaux portait en lui une émotion très russe – ce fugitif répit après un cataclysme historique de plus, cette joie d'avoir terminé une guerre, d'avoir survécu à des répressions meurtrières. Nous errâmes à travers ses rues encore humides, couvertes de sable et de vase. Les habitants entassaient devant leurs portes des meubles et des vêtements pour les faire sécher – comme le font les Russes après un hiver qu'ils commencent à croire éternel.
Et puis, quand Paris resplendit de nouveau dans la fraîcheur de son air printanier dont nous devinions intuitivement le goût – un convoi féerique entraîné par une locomotive enguirlandée ralentit sa marche et s'arrêta aux portes de la ville, devant le pavillon de la gare du Ranelagh.
Un homme jeune portant une simple tunique militaire descendit du wagon en marchant sur la pourpre étalée sous ses pieds. Il était accompagné d'une femme, très jeune aussi, en robe blanche, avec un boa de plumes. Un homme plus âgé, en grand habit, à la magnifique moustache et avec un beau ruban bleu sur la poitrine se détacha d'une impressionnante assemblée groupée sous le portique du pavillon et alla à la rencontre du couple. Le vent doux caressait les orchidées et les amarantes qui ornaient les colonnes, animait l'aigrette sur le chapeau de velours blanc de la jeune femme. Les deux hommes se serrèrent la main…