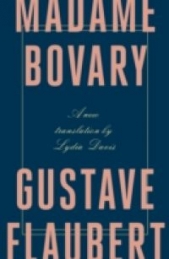Lettres De Mon Moulin

Lettres De Mon Moulin читать книгу онлайн
Ce recueil de nouvelles (ou lettres) d’Alphonse Daudet a ?t? publi? chez Hetzel en 1869.
Ces lettres ont ?t? r?dig?es en partie avec Paul Ar?ne entre 1866 et 1869 et publi?es tout d’abord dans la presse (Le Figaro, L’Ev?nement, Le Bien Public)
L’?dition originale ne comportait que 19 lettres. Celle de 1879, chez le m?me ?diteur en comporte 24.
Le premier charme de ce recueil est de restituer les odeurs de la Provence et d’y camper des personnages pittoresques: le cur? gourmand, l’amoureux, le po?te, le berger, le joueur de fifre, les voyageurs de la diligence… Dans ce recueil Daudet parvient aussi ? allier tendresse et malice. Il se moque avec gentillesse des manies d’un pape avignonnais, des douaniers paresseux, d’un pr?tre ?picurien, ou d’une femme l?g?re…
Les Lettres de mon Moulin est aujourd’hui l’?uvre de Daudet la plus connue. Pourtant ? la parution, elle passa quasiment inaper?ue. C’est Daudet lui m?me qui raconte: « Le volume parut chez Hetzel en 1869, se vendit p?niblement ? deux mille exemplaires, attendant comme les autres ?uvres e mes d?buts, que la vogue des romans leur fit un regain de vente et de publicit?. N’importe! C’est encore l? mon livre pr?f?r?, non pas au point de vue litt?raire, mais parce qu’il me rappelle les plus belles heures de ma jeunesse, rires fous, ivresses sans remords, des visages et des aspects amis que je ne reverrai plus jamais ».
Jeune encore et d?j? lass? du sombre et bruyant Paris, Alphonse Daudet vient de passer les ?t?s dans son moulin de Fontvielle, " piqu? comme un papillon " sur la colline parmi les lapins. Dans cette ruine ensoleill?e de la vall?e du Rh?ne, naissent ces contes immortels qui assureront sa gloire. Au loin, on entend la trompe de Monsieur Seguin sonnant sa jolie ch?vre blanche. Dans le petit bois de ch?nes verts, un sous-pr?fet s'endort en faisant des vers. Au ciel, o? les ?toiles se marient entre elles, le Cur? de Cucugnan compte ses malheureux paroissiens. Et dans la ville voisine, un jeune paysan meurt d'amour pour une petite Arl?sienne tout en velours et dentelles qu'on ne verra jamais. Le vieux moulins abandonn? est devenu l'?me et l'esprit de la Provence. Dans le silence des Alpilles ou le trapage des cigales et des tambourins, parfum?s d'?motions, de sourires et de larmes, ces contes semblent frapp?s d'une ?ternelle jeunesse.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Pensez quelle confusion le lendemain, quand ses voisins de cellule lui faisaient d’un air malin:
«Eh! eh! père Gaucher, vous aviez des cigales en tête, hier soir en vous couchant.»
Alors c’étaient des larmes, des désespoirs, et le jeûne, et le cilice, et la discipline. Mais rien ne pouvait contre le démon de l’élixir; et tous les soirs, à la même heure, la possession recommençait.
Pendant ce temps, les commandes pleuvaient à l’abbaye que c’était bénédiction. Il en venait de Nîmes, d’Aix, d’Avignon, de Marseille… De jour en jour le couvent prenait un petit air de manufacture. Il y avait des frères emballeurs, des frères étiqueteurs, d’autres pour les écritures, d’autres pour le camionnage; le service de Dieu y perdait bien par-ci, par-là quelques coups de cloches; mais les pauvres gens du pays n’y perdaient rien, je vous en réponds…
Et donc, un beau dimanche matin, pendant que l’argentier lisait en plein chapitre son inventaire de fin d’année et que les bons chanoines l’écoutaient les yeux brillants et le sourire aux lèvres, voilà le père Gaucher qui se précipite au milieu de la conférence en criant:
«C’est fini… Je n’en fais plus… Rendez-moi mes vaches.
– Qu’est-ce qu’il y a donc, père Gaucher? demanda le prieur, qui se doutait bien un peu de ce qu’il y avait.
– Ce qu’il y a, monseigneur? Il y a que je suis en train de me préparer une belle éternité de flammes et de coup de fourche… Il y a que je bois, que je bois comme un misérable…
– Mais je vous avais dit de compter vos gouttes.
– Ah! bien oui, compter mes gouttes! c’est par gobelets qu’il faudrait compter maintenant… Oui, mes révérends, j’en suis là. Trois fioles par soirée… Vous comprenez bien que cela ne peut pas durer… Aussi, faites faire l’élixir par qui vous voudrez… Que le feu de Dieu me brûle si je m’en mêle encore!»
C’est le chapitre qui ne riait plus.
«Mais, malheureux, vous nous ruinez! criait l’argentier en agitant son grand livre.
– Préférez-vous que je me damne?»
Pour lors, le prieur se leva.
«Mes révérends, dit-il en étendant sa belle main blanche où luisait l’anneau pastoral, il y a un moyen de tout arranger… C’est le soir, n’est-ce pas, mon cher fils, que le démon vous tente?…
– Oui, monsieur le prieur, régulièrement tous les soirs… Aussi, maintenant, quand je vois arriver la nuit, j’en ai, sauf votre respect, les sueurs qui me prennent, comme l’âne du Capitou, quand il voyait venir le bât.
– Eh bien, rassurez-vous… Dorénavant, tous les soirs à l’office, nous réciterons à votre intention l’oraison de saint Augustin à laquelle l’indulgence plénière est attachée… Avec cela, quoi qu’il arrive, vous êtes couvert… C’est l’absolution pendant le péché.
– Oh! bien, alors, merci, monsieur le prieur!»
Et, sans en demander davantage, le père Gaucher retourna à ses alambics, aussi léger qu’une alouette.
Effectivement, à partir de ce moment-là, tous les soirs à la fin des complies, l’officiant ne manquait jamais de dire:
«Prions pour notre pauvre père Gaucher, qui sacrifie son âme aux intérêts de la communauté… Oremus, Domine…»
Et pendant que sur toutes ces capuches blanches, prosternées dans l’ombre des nefs, l’oraison courait en frémissant comme une petite bise sur la neige, là-bas, tout au bout du couvent, derrière le vitrage enflammé de la distillerie, on entendait le père Gaucher qui chantait à tue-tête:
… Ici le bon curé s’arrêta plein d’épouvante:
«Miséricorde! si mes paroissiens m’entendaient!»
En Camargue
1 – Le départ
Grande rumeur au château. Le messager vient d’apporter un mot du garde, moitié en français, moitié en provençal, annonçant qu’il y a eu déjà deux ou trois beaux passages de Galéjons, de Charlottines, et que les oiseaux de prime non plus ne manquaient pas.
«Vous êtes des nôtres!» m’ont écrit mes aimables voisins: et ce matin, au petit jour de cinq heures, leur grand break chargé de fusils, de chiens, de victuailles, est venu me prendre au bas de la côte. Nous voilà roulant sur la route d’Arles, un peu sèche, un peu dépouillée, par ce matin de décembre où la verdure pâle des oliviers est à peine visible, et la verdure crue des chênes kermès un peu trop hivernale et factice. Les étables se remuent. Il y a des réveils avant le jour qui allument la vitre des fermes; et dans les découpures de pierre de l’abbaye de Montmajour, des orfraies comme engourdies de sommeil battent de l’aile parmi les ruines. Pourtant nous croisons déjà, le long des fossés, de vieilles paysannes qui vont au marché au trot de leurs bourriquets. Elles viennent de la ville des Baux. Six grandes lieues pour s’asseoir une heure sur les marches de Saint-Trophime et vendre des petits paquets de simples ramassés dans la montagne!…
Maintenant voici les remparts d’Arles; des remparts bas et crénelés, comme on en voit sur les anciennes estampes où des guerriers armés de lances apparaissent en haut de talus moins grands qu’eux. Nous traversons au galop cette merveilleuse petite ville, une des plus pittoresques de France, avec ses balcons sculptés, arrondis, s’avançant comme des moucharabiehs jusqu’au milieu des rues étroites, avec ses vieilles maisons noires aux petites portes, moresques, ogivales et basses, qui vous reportent au temps de Guillaume Court-Nez et des Sarrasins. A cette heure, il n’y a encore personne dehors. Le quai du Rhône seul est animé. Le bateau à vapeur qui fait le service de la Camargue chauffe au bas des marches, prêt à partir. Des ménagers en veste de cadis roux, des filles de La Roquette qui vont se louer pour les travaux des fermes, montent sur le pont avec nous, causant et riant entre eux. Sous les longues mantes brunes rabattues à cause de l’air vif du matin, la haute coiffure arlésienne fait la tête élégante et petite avec un joli grain d’effronterie, une envie de se dresser pour lancer le rire ou la malice plus loin… La cloche sonne; nous partons. Avec la triple vitesse du Rhône, de l’hélice, du mistral, les deux rivages se déroulent. D’un côté c’est la Crau, une plaine aride, pierreuse. De l’autre, la Camargue, plus verte, qui prolonge jusqu’à la mer son herbe courte et ses marais pleins de roseaux.
De temps en temps le bateau s’arrête près d’un ponton, à gauche ou à droite, à Empire ou à Royaume, comme on disait au Moyen Age, du temps du royaume d’Arles, et comme les vieux mariniers du Rhône disent encore aujourd’hui. A chaque ponton, une ferme blanche, un bouquet d’arbres. Les travailleurs descendent chargés d’outils, les femmes leur panier au bras, droites sur la passerelle. Vers Empire ou vers Royaume peu à peu le bateau se vide, et quand il arrive au ponton du Mas-de-Giraud où nous descendons, il n’y a presque plus personne à bord.