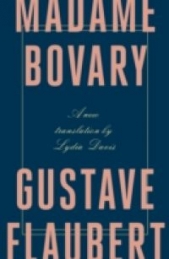Le testament fran?ais

Le testament fran?ais читать книгу онлайн
Ce roman a l’originalit? de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, ? travers les nombreux r?cits que Charlotte Lemonnier, «?gar?e dans l’immensit? neigeuse de la Russie», raconte ? son petit-fils et confident.
Ce roman a re?u le prix Goncourt 1995 et ex-aequo le prix M?dicis 1995.
***
«Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans ga?t?, Charlotte m'avait dit qu'apr?s tous ses voyages ? travers l'immense Russie, venir ? pied jusqu'en France n'aurait pour elle rien d'impossible […]. Au d?but, pendant de longs mois de mis?re et d'errances, mon r?ve fou ressemblerait de pr?s ? cette bravade. J'imaginerais une femme v?tue de noir qui, aux toutes premi?res heures d'une matin?e d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville frontali?re […]. Elle pousserait la porte d'un caf? au coin d'une ?troite place endormie, s'installerait pr?s de la fen?tre, ? c?t? d'un calorif?re. La patronne lui apporterait une tasse de th?. Et en regardant, derri?re la vitre, la face tranquille des maisons ? colombages, la femme murmurerait tout bas: "C'est la France… Je suis retourn?e en France. Apr?s… apr?s toute une vie."»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
L'instructeur poussa un cri de joie en montrant à tout le monde son chronomètre: «Une minute quinze secondes!» C'était le meilleur temps. La rouquine se retourna, radieuse. Et, enlevant son calot, elle secoua la tête. Ses cheveux s'enflammèrent dans le soleil, ses taches de rousseur jaillirent comme des étincelles. Je fermai les yeux.
Et le lendemain, pour la première fois de ma vie, je découvrais cette volupté très singulière de serrer une arme à feu, une Kalachnikov, et de sentir ses tressaillements nerveux contre mon épaule. Et de voir, au loin, une silhouette en contrepla-qué se couvrir de trous. Oui, ses secousses insistantes, sa force mâle étaient pour moi d'une nature profondément sensuelle.
D'ailleurs, dès la première rafale, ma tête se remplit d'un silence bourdonnant. Mon voisin de gauche avait tiré le premier et m'avait assourdi. Ce carillon incessant dans mes oreilles, les gerbes irisées du soleil dans mes cils, l'odeur fauve de la terre sous mon corps – j'étais au comble du bonheur.
Car enfin je revenais à la vie. Je lui trouvai un sens. Vivre dans la bienheureuse simplicité de ces gestes ordonnés: tirer, marcher en rang, manger dans des gamelles en aluminium la kacha de mil. Se laisser porter dans un mouvement collectif dirigé par les autres. Par ceux qui connaissaient l'objectif suprême. Ceux qui, généreusement, ôtaient tout le poids de notre responsabilité, nous rendant légers, transparents, nets. Cet objectif était, lui aussi, simple et univoque: défendre la patrie. Je me hâtai de me fondre dans ce but monumental, de me dissoudre dans la masse merveilleusement irresponsable de mes camarades. Je jetais des grenades d'exercice, je tirais, je plantais une tente. Heureux. Béat. Sain. Et avec stupeur je me rappelais parfois cet adolescent qui, dans une vieille maison au bord de la steppe, passait des jours entiers à méditer sur la vie et la mort de trois femmes aperçues dans un amoncellement de vieux journaux. Si l'on m'avait présenté ce rêveur, je ne l'aurais sans doute pas reconnu. Je ne me serais pas reconnu…
Le lendemain, l'instructeur nous emmena assister à l'arrivée d'une colonne de chars. Nous discernâmes d'abord un nuage gris qui s'enflait à l'horizon. Puis, une vibration puissante se répandit dans la semelle de nos chaussures. La terre tremblait. Et le nuage devenant jaune s'éleva jusqu'au soleil et l'éclipsa. Tous les bruits disparurent, couverts par le vacarme métallique des chenilles. Le premier canon perça le mur de poussière, le char du commandant surgit, puis le deuxième, le troisième… Et avant de s'arrêter les chars décrivaient une courbe serrée pour se mettre en rang, à côté du précédent. Leurs chenilles alors claquaient encore plus rageusement en déchirant l'herbe en longues lamelles.
Hypnotisé par cette puissance de l'empire, j'imaginai soudain le globe terrestre que ces chars – nos chars! – pouvaient écorcher tout entier. Une brève commande aurait suffi. J'en éprouvai un orgueil encore jamais ressenti…
Et les soldats qui sortaient des tourelles me fascinèrent par leur virilité sereine. Ils étaient tous semblables, taillés dans la même matière ferme et saine. Je les devinais invulnérables à ces pensées caverneuses qui me torturaient durant l'hiver. Non, toute cette vase mentale ne serait pas restée une seule seconde dans le courant limpide de leur raisonnement, simple et direct comme les ordres qu'ils exécutaient. J'étais terriblement jaloux de leur vie. Elle s'exposait là, sous le soleil, sans une tache d'ombre. Leur force, l'odeur mâle de leur corps, leurs vareuses couvertes de poussière. Et la présence, quelque part, de la jeune rousse, de cette adolescente-femme, de cette promesse amoureuse. Je n'avais plus qu'une envie: pouvoir, un jour, m'extraire de la tourelle étroite d'un char, sauter sur ses chenilles, puis sur la terre molle, et marcher d'un pas agréablement fatigué vers la femme-promesse.
Cette vie, une vie en fait très soviétique dans laquelle j'avais toujours vécu en marginal, m'exalta. Me fondre dans sa routine débonnaire et collectiviste m'apparut soudain comme une solution lumineuse. Vivre de la vie de tout le monde! Conduire un char, puis, démobilisé, faire couler l'acier au milieu des machines d'une grande usine au bord de la Volga, aller, chaque samedi, au stade pour voir un match de football. Mais surtout savoir que cette suite de jours, tranquille et prévisible, était couronnée d'un grand projet messianique – ce communisme qui, un jour, nous rendrait tous constamment heureux, cristallins dans nos pensées, strictement égaux…
C'est là qu'en rasant presque les sommets de la forêt, les avions de chasse surgirent au-dessus de nos têtes. Volant par groupe de trois, ils firent écrouler sur nous le ciel explosé. Vague après vague, ils déferlaient en éventrant l'air, m'inci-sant le cerveau par leurs décibels.
Plus tard, dans le silence du soir, j'observais longuement la plaine déserte avec les rayures sombres de l'herbe arrachée çà et là. Je me disais qu'il était une fois un enfant qui avait imaginé une ville fabuleuse s'élevant au-dessus de cet horizon brumeux… Cet enfant n'était plus. J'étais guéri.
Depuis ce jour d'avril mémorable, la mini-société scolaire m'accepta. Ils m'accueillirent avec cette générosité condescendante qu'on a pour les néophytes, pour les reconvertis zélés ou les repentis enthousiastes. Je l'étais. À tout moment, je tenais à leur montrer que ma singularité avait été définitivement dépassée. Que j'étais comme eux. Et en plus, prêt à tout pour expier ma marginalité.
Au reste, la mini-société elle-même avait, entre-temps, changé. Copiant de mieux en mieux le monde des adultes, elle s'était divisée en quelques clans. Oui, presque en classes sociales! J'en distinguai trois. Elles préfiguraient déjà l'avenir de ces adolescents, hier encore unis dans une petite meute homogène. A présent, il y avait là un groupe de «prolétaires». Les plus nombreux, ils étaient issus, pour la plupart, de familles ouvrières qui fournissaient en main-d'œuvre les ateliers de l'énorme port fluvial. Il y avait, en outre, un noyau de forts en mathématiques, futurs «tekhnars » qui, autrefois mélangés aux prolétaires et dominés par eux, s'en démarquaient de plus en plus en occupant le devant de la scène scolaire. Enfin, la plus fermée et la plus élitiste, la plus restreinte aussi, cette coterie dans laquelle on reconnaissait l'intelligentsia en herbe.
Je devenais des leurs dans chacune de ces classes. Ma présence intermédiaire était appréciée par tout le monde. À un certain moment, je me crus même irremplaçable. Grâce à… la France!
Car, guéri d'elle, je la racontais. J'étais heureux de pouvoir confier à ceux qui m'avaient accepté parmi eux tout ce stock d'anecdotes accumulées depuis des années. Mes récits plaisaient. Batailles dans les catacombes, cuisses de grenouilles payées à prix d'or, rues entières livrées à l'amour vénal à Paris – ces sujets me valurent la réputation d'un conteur patenté.
Je parlais et je sentais que ma guérison était complète. Les accès de cette folie qui m'avait autrefois plongé dans la vertigineuse sensation du passé ne se répétaient plus. La France devenait une simple matière à raconter. Amusante, exotique aux yeux de mes collègues, excitante quand je décrivais «l'amour à la française», mais en somme peu différente des histoires drôles, souvent graveleuses, que nous nous racontions pendant les récréations en tirant sur nos cigarettes hâtives.
Je remarquai assez rapidement qu'il fallait assaisonner mes récits français selon le goût de mes interlocuteurs. La même histoire changeait de ton selon que je la racontais aux «prolétaires», aux «tekhnars » ou bien aux «intellectuels». Fier de mon talent de conférencier, je variais les genres, adaptais les niveaux de style, triais les mots. Ainsi, pour plaire aux premiers, je m'attardais longuement sur les ébats torrides du Président et de Marguerite. Un homme, de surcroît un président de la République, qui mourait d'avoir trop fait l'amour – ce tableau, à lui seul, les portait à l'extase. Les «tekhnars», eux, étaient plus sensibles aux péripéties de l'intrigue psychologique. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé à Marguerite après ce coup d'éclat amoureux. Je parlais alors du mystérieux double meurtre dans l'impasse Ronsin, de cette terrible matinée de mai où l'on avait découvert le mari de Marguerite strangulé à l'aide d'un cordon de tirage, sa belle-mère, étranglée elle aussi, mais avec son propre râtelier… Je n'oubliais pas de préciser que le mari, peintre de son état, croulait sous les commandes officielles, tandis que son épouse n'avait jamais renoncé à ses amitiés haut placées. Et que d'après une version, c'est l'un des successeurs de feu Félix Faure, visiblement un ministre, qui avait été surpris par le mari…
Quant aux «intellectuels», le sujet paraissait ne pas les toucher. Certains pour montrer leur désintérêt poussaient même un bâillement de temps à autre. Ils se départirent de ce flegme feint, seulement en trouvant un prétexte pour faire des jeux de mots. Le nom de «Faure» fut vite victime d'un calembour: «donner à Faure» signifiait en russe «donner des points à son rival». Les rires, savamment blasés, fusèrent. Quelqu'un, toujours avec ce même petit rire indolent, lança: «Quel for-ward, Faure!» en sous-entendant l'avant du football. Un autre, en arborant la mine d'un simple d'esprit, parla de la fortotchka , le vasistas… Je me rendis compte que la langue pratiquée dans cet étroit cercle se composait presque exclusivement de ces mots détournés, rébus, phrases maniérées tournures connues seulement de ses membres. Avec un mélange d'admiration et d'angoisse, je constatai que leur langue n'avait pas besoin du monde qui nous entourait – de ce soleil, de ce vent! Bientôt, je parvenais à imiter facilement ces jongleurs de mots…
La seule personne qui n'apprécia pas mon retournement fut Pachka, ce cancre dont je partageais autrefois les parties de pêche. De temps en temps, il s'approchait de notre groupe, nous écoutait et quand je me mettais à raconter mes histoires françaises, il me fixait d'un air méfiant.
Un jour, l'attroupement autour de moi fut plus nombreux que d'habitude. Mon récit devait les intéresser particulièrement. Je parlais (en résumant le roman de ce pauvre Spivalski accusé de tous les péchés mortels et tué à Paris) des deux amants qui avaient passé une longue nuit dans un train presque vide, fuyant à travers l'empire moribond des tsars. Le lendemain, ils se séparaient à jamais…