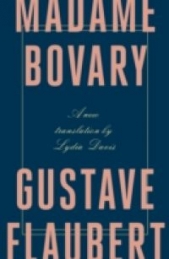Le pere Goriot

Le pere Goriot читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Quand une femme dit à un jeune homme qu’elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s’il a quinze cents francs d’oisiveté dans sa poche, il doit penser ce que se disait Eugène, et devient fat.
— Que pouvez-vous désirer ? répondit-il. Vous êtes belle, jeune, aimée, riche.
— Ne parlons pas de moi, dit-elle en faisant un sinistre mouvement de tête. Nous dînerons ensemble, tête à tête, nous irons entendre la plus délicieuse musique. Suis-je à votre goût ? reprit-elle en se levant et montrant sa robe en cachemire blanc à dessins perses de la plus riche élégance.
— Je voudrais que vous fussiez toute à moi, dit Eugène. Vous êtes charmante.
— Vous auriez une triste propriété, dit-elle en souriant avec amertume. Rien ici ne vous annonce le malheur, et cependant, malgré ces apparences, je suis au désespoir. Mes chagrins m’ôtent le sommeil, je deviendrai laide.
— Oh ! cela est impossible, dit l’étudiant. Mais je suis curieux de connaître ces peines qu’un amour dévoué n’effacerait pas ?
— Ah ! si je vous les confiais, vous me fuiriez, dit-elle. Vous ne m’aimez encore que par une galanterie qui est de costume chez les hommes ; mais si vous m’aimiez bien, vous tomberiez dans un désespoir affreux. Vous voyez que je dois me taire. De grâce, reprit-elle, parlons d’autre chose. Venez voir mes appartements.
— Non, restons ici, répondit Eugène en s’asseyant sur une causeuse devant le feu près de madame de Nucingen, dont il prit la main avec assurance.
Elle la laissa prendre et l’appuya même sur celle du jeune homme par un de ces mouvements de force concentrée qui trahissent de fortes émotions.
— Écoutez, lui dit Rastignac ; si vous avez des chagrins, vous devez me les confier. Je veux vous prouver que je vous aime pour vous. Ou vous parlerez et me direz vos peines afin que je puisse les dissiper, fallût-il tuer six hommes, où je sortirai pour ne plus revenir.
— Eh ! bien, s’écria-t-elle saisie par une pensée de désespoir qui la fit se frapper le front, je vais vous mettre à l’instant même à l’épreuve. Oui, se dit-elle, il n’est plus que ce moyen. Elle sonna.
— La voiture de monsieur est-elle attelée ? dit-elle à son valet de chambre.
— Oui, madame.
— Je la prends. Vous lui donnerez la mienne et mes chevaux. Vous ne servirez le dîner qu’à sept heures.
— Allons, venez, dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nucingen, à coté de cette femme.
— Au Palais-Royal, dit-elle au cocher, près du Théâtre-Français.
En route, elle parut agitée, et refusa de répondre aux mille interrogations d’Eugène, qui ne savait que penser de cette résistance muette, compacte, obtuse.
— En un moment elle m’échappe, se disait-il.
Quand la voiture s’arrêta, la baronne regarda l’étudiant d’un air qui imposa silence à ses folles paroles ; car il s’était emporté.
— Vous m’aimez bien ? dit-elle.
— Oui, répondit-il en cachant l’inquiétude dont il fut soudainement saisi.
— Vous ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous demander ?
— Non.
— Êtes-vous disposé à m’obéir ?
— Aveuglément.
— Avez-vous été au jeu ? dit-elle d’une voix tremblante.
— Jamais.
— Ah ! je respire. Vous aurez du bonheur. Voici ma bourse, dit-elle. Prenez donc ! il y a cent francs, c’est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu, je ne sais où elles sont, mais je sais qu’il y en a au Palais-Royal. Risquez les cent francs à un jeu qu’on nomme la roulette, et perdez tout, ou rapportez-moi six mille francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour.
— Je veux bien que le diable m’emporte si je comprends quelque chose à ce que je vais faire, mais je vais vous obéir, dit-il avec une joie causée par cette pensée : « Elle se compromet avec moi, elle n’aura rien à me refuser. »
Eugène prend la jolie bourse, court au numéro NEUF, après s’être fait indiquer par un marchand d’habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monte, se laisse prendre son chapeau, mais il entre et demande où est la roulette. À l’étonnement des habitués, le garçon de salle le mène devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demande sans vergogne où il faut mettre l’enjeu.
— Si vous placez un louis sur un seul de ces trente-six numéros, et qu’il sorte, vous aurez trente-six louis, lui dit un vieillard respectable à cheveux blancs.
Eugène jette les cent francs sur le chiffre de son âge, vingt et un. Un cri d’étonnement part sans qu’il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir.
— Retirez donc votre argent, lui dit le vieux monsieur, l’on ne gagne pas deux fois dans ce système-là.
Eugène prend un râteau que lui tend le vieux monsieur, il tire à lui les trois mille six cents francs et, toujours sans rien savoir du jeu, les place sur la rouge. La galerie le regarde avec envie, en voyant qu’il continue à jouer. La roue tourne, il gagne encore, et le banquier lui jette encore trois mille six cents francs.
— Vous avez sept mille deux cents francs à vous, lui dit à l’oreille le vieux monsieur. Si vous m’en croyez, vous vous en irez, la rouge a passé huit fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d’un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin.
Rastignac étourdi se laisse prendre dix louis par l’homme à cheveux blancs, et descend avec les sept mille francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur.
— Ah çà ! où me mènerez-vous maintenant, dit-il en montrant les sept mille francs à madame de Nucingen quand la portière fut refermée.
Delphine le serra par une étreinte folle et l’embrassa vivement, mais sans passion. — Vous m’avez sauvée ! Des larmes de joie coulèrent en abondance sur ses joues. Je vais tout vous dire, mon ami. Vous serez mon ami, n’est-ce pas ? Vous me voyez riche, opulente, rien ne me [] manque ou je parais ne manquer de rien ! Eh ! bien, sachez que monsieur de Nucingen ne me laisse pas disposer d’un sou : il paye toute la maison, mes voitures, mes loges ; il m’alloue pour ma toilette une somme insuffisante, il me réduit à une misère secrète par calcul. Je suis trop fière pour l’implorer. Ne serais-je pas la dernière des créatures si j’achetais son argent au prix où il veut me le vendre ! Comment, moi riche de sept cent mille francs, me suis-je laissé dépouiller ? par fierté, par indignation. Nous sommes si jeunes, si naïves, quand nous commençons la vie conjugale ! La parole par laquelle il fallait demander de l’argent à mon mari me déchirait la bouche ; je n’osais jamais, je mangeais l’argent de mes économies et celui que me donnait mon pauvre père ; puis je me suis endettée. Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions, je ne puis vous en parler : qu’il vous suffise de savoir que je me jetterais par la fenêtre s’il fallait vivre avec Nucingen autrement qu’en ayant chacun notre appartement séparé. Quand il a fallu lui déclarer mes dettes de jeune femme, des bijoux, des fantaisies (mon pauvre père nous avait accoutumées à ne nous rien refuser), j’ai souffert le martyre ; mais enfin j’ai trouvé le courage de les dire. N’avais-je pas une fortune à moi ? Nucingen s’est emporté, il m’a dit que je le ruinerais, des horreurs ! J’aurais voulu être à cent pieds sous terre. Comme il avait pris ma dot, il a payé ; mais en stipulant désormais pour mes dépenses personnelles une pension à laquelle je me suis résignée, afin d’avoir la paix. Depuis, j’ai voulu répondre à l’amour-propre de quelqu’un que vous connaissez, dit-elle. Si j’ai été trompée par lui, je serais mal venue à ne pas rendre justice à la noblesse de son caractère. Mais enfin il m’a quittée indignement ! Onne devrait jamais abandonner une femme à laquelle on a jeté, dans un jour de détresse, un tas d’or ! Ondoit l’aimer toujours ! Vous, belle âme de vingt et un ans, vous jeune et pur, vous me demanderez comment une femme peut accepter de l’or d’un homme ? Mon Dieu ! n’est-il pas naturel de tout partager avec l’être auquel nous devons notre bonheur ? Quand on s’est tout donné, qui pourrait s’inquiéter d’une parcelle de ce tout ? L’argent ne devient quelque chose qu’au moment où le sentiment n’est plus. N’est-on pas lié pour la vie ? Qui de nous prévoit une séparation en se croyant bien aimée ? Vous nous jurez un amour éternel, comment avoir alors des intérêts distincts ? Vous ne savez pas ce que j’ai souffert aujourd’hui, lorsque Nucingen m’a positivement refusé de me donner six mille francs, lui qui les donne tous les mois à sa maîtresse, une fille de l’Opéra ! Je voulais me tuer. Les idées les plus folles me passaient par la tête. Il y a eu des moments où j’enviais le sort d’une servante, de ma femme de chambre. Aller trouver mon père, folie ! Anastasie et moi nous l’avons égorgé : mon pauvre père se serait vendu s’il pouvait valoir six mille francs. J’aurais été le désespérer en vain. Vous m’avez sauvée de la honte et de la mort, j’étais ivre de douleur. Ah ! monsieur, je vous devais cette explication : j’ai été bien déraisonnablement folle avec vous. Quand vous m’avez quittée, et que je vous ai eu perdu de vue, je voulais m’enfuir à pied… où ? je ne sais. Voilà la vie de la moitié des femmes de Paris : un luxe extérieur, des soucis cruels dans l’âme. Je connais de pauvres créatures encore plus malheureuses que je ne le suis. Il y a pourtant des femmes obligées de faire faire de faux mémoires par leurs fournisseurs. D’autres sont forcées de voler leurs maris : les uns croient que des cachemires de cent louis se donnent pour cinq cents francs, les autres qu’un cachemire de cinq cents francs vaut cent louis. Il se rencontre de pauvres femmes qui font jeûner leurs enfants, et grappillent pour avoir une robe. Moi, je suis pure de ces odieuses tromperies. Voici ma dernière angoisse. Si quelques femmes se vendent à leurs maris pour les gouverner, moi au moins je suis libre ! Je pourrais me faire couvrir d’or par Nucingen, et je préfère pleurer la tête appuyée sur le cœur d’un homme que je puisse estimer. Ah ! ce soir monsieur de Marsay n’aura pas le droit de me regarder comme une femme qu’il a payée. Elle se mit le visage dans ses mains, pour ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la contempler, elle était sublime ainsi.