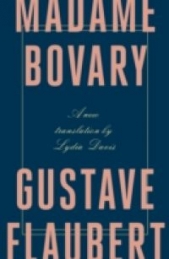LIdiot. Tome I

LIdiot. Tome I читать книгу онлайн
Le prince Mychkine est un ?tre fondamentalement bon, mais sa bont? confine ? la na?vet? et ? l'idiotie, m?me s'il est capable d'analyses psychologiques tr?s fines. Apr?s avoir pass? sa jeunesse en Suisse dans un sanatorium pour soigner son ?pilepsie (maladie dont ?tait ?galement atteint Dosto?evski) doubl?e d'une sorte d'autisme, il retourne en Russie pour p?n?trer les cercles ferm?s de la soci?t? russe. Lors de la soir?e d'anniversaire de Nastassia Filippovna, le prince Mychkine voit un jeune bourgeois, Parfen Semenovitch Rogojine arriver ivre et offrir une forte somme d'argent ? la jeune femme pour qu'elle le suive. Le prince per?oit le d?sespoir de Nastasia Philippovna, en tombe maladivement amoureux, et lui propose de l'?pouser. Apr?s avoir accept? son offre, elle s'enfuit pourtant avec Rogojine. Constatant leur rivalit?, Rogojine tente de tuer le prince mais ce dernier est paradoxalement sauv? par une crise d'?pilepsie qui le fait s'?crouler juste avant le meurtre… Ayant cr?? des liens aupr?s de la famille Epantchine, il fait la connaissance d'une soci?t? petersbourgeoise m?lant des bourgeois, des ivrognes, des anciens militaires et des fonctionnaires fielleux. Se trouvant du jour au lendemain ? la t?te d'une grande fortune, il avive la curiosit? de la soci?t? p?tersbourgeoise et vient s'installer dans un lieu de vill?giature couru, le village de Pavlovsk…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Le prince se tut et regarda ses auditrices.
– Voilà qui ne ressemble guère à du quiétisme, murmura Alexandra en se parlant à elle-même.
– Eh bien! maintenant, racontez-nous comment vous êtes tombé amoureux, dit Adélaïde.
Le prince la considéra avec surprise.
– Écoutez, fit Adélaïde sur un ton précipité, gardez en réserve la description du tableau de Bâle. Pour le moment, je veux vous entendre raconter comment vous êtes tombé amoureux. Ne niez pas: vous avez été amoureux. D’autant qu’il vous suffit de vous mettre à raconter quelque chose pour vous départir de votre philosophie.
– Et, dès que votre récit sera terminé, vous serez confus de nous l’avoir fait, observa soudain Aglaé. Pour quelle raison?
– C’est trop bête à la fin! intervint la générale en fixant sur Aglaé un regard indigné.
– C’est déraisonnable, appuya Alexandra.
– Ne la croyez pas, prince! reprit la générale. Elle fait exprès de prendre ce mauvais genre, mais elle n’a pas été élevée si sottement; n’allez pas imaginer quoi que ce soit en les voyant vous taquiner ainsi. Sans doute elles ont quelque fantaisie en tête, mais elles éprouvent déjà de l’affection pour vous. Je connais leurs visages.
– Moi aussi je les connais, dit le prince en appuyant sur les mots avec une insistance particulière.
– Comment cela? demanda Adélaïde avec curiosité.
– Que savez-vous de nos visages? ajoutèrent les deux autres également intriguées.
Mais le prince se tut et prit un air sérieux. Tout le monde attendait sa réponse.
– Je vous le dirai plus tard, fit-il avec douceur et gravité.
– Décidément vous voulez piquer notre curiosité, s’exclama Aglaé. Quel ton solennel!
– Eh bien, soit! reprit vivement Adélaïde. Cependant, si vous êtes si bon physionomiste, c’est que vous avez été amoureux. Donc j’ai deviné juste. Racontez-nous cela.
– Je n’ai pas été amoureux, répondit le prince du même ton doux et grave. J’ai été heureux… d’une autre manière.
– De quelle manière? Par quoi?
– C’est bien, je vais vous le dire, articula-t-il avec l’air d’un homme plongé dans une profonde rêverie.
VI
– Oui, commença le prince, en ce moment vous me regardez toutes avec une si vive curiosité que, si je ne la satisfaisais pas, vous vous fâcheriez contre moi. Non, je plaisante, reprit-il aussitôt en souriant. Là-bas… dans ce village suisse, il y avait toujours des enfants; je passais tout mon temps avec eux et rien qu’avec eux. C’était toute la bande des écoliers du village. On ne peut pas dire que je les instruisais; oh non! c’était l’affaire du maître d’école, qui s’appelait Jules Thibaut; mettons que j’aie contribué à leur instruction, mais il est plus exact de dire que j’ai vécu parmi eux et que c’est ainsi que se sont écoulées mes quatre années. Je n’avais pas besoin d’une autre société. Je leur disais tout, je ne leur cachais rien. Leurs pères et parents se fâchèrent tous contre moi parce que ces enfants finissaient par ne plus pouvoir se passer de moi; ils se groupaient toujours à mes côtés, si bien que le maître d’école lui-même devint mon plus grand ennemi. Je m’aliénai là-bas beaucoup d’autres gens, toujours à cause des enfants. Schneider même me gourmanda à ce sujet. Qu’appréhendaient-ils donc? On peut tout dire à un enfant, tout; j’ai toujours été surpris de voir combien les grandes personnes, à commencer par les pères et mères, connaissaient mal les enfants. On ne doit rien cacher aux enfants sous le prétexte qu’ils sont petits et qu’il est trop tôt pour leur apprendre quelque chose. Quelle triste et malencontreuse idée! Les enfants eux-mêmes s’aperçoivent que leurs parents les croient trop petits et incapables de comprendre, alors qu’en réalité ils comprennent tout. Les grandes personnes ne savent pas qu’un enfant peut donner un conseil de la plus haute importance, même dans une affaire extrêmement compliquée. Oh mon Dieu! quand un de ces jolis oisillons vous regarde avec son air confiant et heureux, vous avez honte de le tromper! Si je les appelle oisillons, c’est parce qu’il n’y a rien au monde de meilleur qu’un petit oiseau. D’ailleurs, si tout le monde m’en a voulu au village, cela a été surtout la conséquence d’un incident… Quant à Thibaut c’était simplement la jalousie qui l’indisposait à mon égard; il commença par hocher la tête et s’étonner de voir les enfants saisir tout ce que je leur disais, tandis qu’il se faisait à peine comprendre d’eux. Puis il se mit à se moquer de moi lorsque je lui déclarai que ni lui ni moi ne leur apprendrions rien, et que c’était plutôt d’eux que nous avions à apprendre. Comment a-t-il pu m’envier et me calomnier, alors que lui-même vivait au milieu des enfants? au contact des enfants l’âme s’assainit… Ainsi, il y avait là-bas un malade dans la maison de santé que dirigeait Schneider; c’était un homme très malheureux. Son malheur était si affreux qu’on n’en saurait guère concevoir de semblable. Il était en traitement pour aliénation mentale; à mon avis il n’était pas fou; mais il souffrait horriblement et c’était là toute sa maladie. Et si vous saviez ce que finirent par être pour lui nos enfants! Mais je reviendrai plus tard sur le cas de ce malade; pour le moment je vais vous raconter comment tout cela a commencé. Au début les enfants ne m’aimèrent point. J’étais trop grand pour eux et j’ai toujours été d’allures gauches; je sais que je suis laid de ma personne… enfin il y avait le fait que j’étais un étranger. Les enfants se moquèrent d’abord de moi, puis ils me jetèrent des pierres le jour où ils me virent embrasser Marie. Je ne l’ai embrassée qu’une seule fois… Non, ne riez pas, se hâta d’ajouter le prince pour arrêter un sourire de ses auditrices; – ce n’était pas un baiser d’amour. Si vous saviez quelle infortunée créature c’était, vous en auriez autant pitié que moi-même. Elle était de notre village. Sa mère était une très vieille femme qui partageait avec elle une masure délabrée, éclairée par deux fenêtres; une de ces fenêtres était barrée par une planche sur laquelle, avec la permission des autorités locales, elle mettait en vente des lacets, du fil, du tabac, du savon; les quelques sous qu’elle tirait de ce commerce la faisaient vivre. Elle était malade et ses jambes enflées l’obligeaient à rester toujours assise. Sa fille, Marie, qui pouvait avoir vingt ans, était faible et malingre; depuis longtemps la phtisie la minait, ce qui ne l’empêchait pas de travailler dehors à la journée et de faire les gros ouvrages, comme laver le plancher, lessiver, balayer les cours, rentrer le bétail. Un commis voyageur français l’avait séduite et emmenée, puis s’était éclipsé au bout de huit jours après l’avoir plantée sur la route. Elle était revenue au logis en mendiant, toute couverte de boue et de haillons, les souliers en pièces. Elle avait marché une semaine entière, couchant à la belle étoile et torturée par le froid. Ses pieds étaient en sang, ses mains enflées et gercées. D’ailleurs elle n’avait jamais été belle, mais ses yeux exprimaient la douceur, la bonté, l’innocence. Elle était prodigieusement taciturne. Une fois, avant sa mésaventure, elle s’était tout à coup mise à chanter au milieu de son travail; je me souviens que la surprise avait été générale et que tout le monde était parti à rire: «Tiens, voilà Marie qui a chanté! Comment! Marie a chanté?» Sa confusion avait été extrême et depuis ce jour elle n’avait plus desserré les dents. Alors on la traitait encore affectueusement, mais quand elle revint au village malade et meurtrie, personne n’eut plus pour elle la moindre pitié. Comme ces gens-là sont durs en pareil cas! Comme leur jugement est brutal! Sa mère fut la première à lui montrer de l’aversion et du mépris. «Tu viens de me déshonorer», lui dit-elle. Elle fut aussi la première à rendre public l’opprobre de sa fille. Lorsqu’on sut au village le retour de Marie, tout le monde accourut pour la voir; presque toute la population, vieillards, enfants, femmes, jeunes filles, se précipita chez la vieille en foule impatiente et curieuse. Marie gisait famélique et déguenillée sur le plancher aux pieds de sa mère et sanglotait. Quand la foule eut envahi la masure, elle se couvrit le visage de ses cheveux épars et se prostra la face contre le sol. Les gens, en cercle autour d’elle, la regardaient comme une bête immonde; les vieux la tançaient et l’invectivaient; les jeunes ricanaient, les femmes l’insultaient et manifestaient la même répulsion qu’en face d’une araignée. La mère restait assise et, loin de désapprouver ces insultes, elle les encourageait en hochant la tête. Elle était déjà très malade et presque mourante; de fait, elle trépassa deux mois plus tard. Bien qu’elle sût sa fin prochaine, l’idée ne lui vint pas de se réconcilier avec sa fille avant de mourir; elle ne lui adressait jamais la parole, l’envoyait se coucher dans l’entrée et lui refusait presque la nourriture. Ses pieds malades exigeaient de fréquents bains tièdes; Marie les lui lavait chaque jour et lui donnait des soins; la vieille acceptait ses services en silence sans la moindre parole affectueuse. La malheureuse endurait tout: lorsque par la suite j’eus fait sa connaissance, je constatai qu’elle-même approuvait ces humiliations et se considérait comme la dernière des créatures. Quand sa mère s’alita pour ne plus se relever, les vieilles femmes du village vinrent la soigner à tour de rôle, comme cela se fait là-bas. On cessa dès lors complètement de nourrir Marie; tout le monde la repoussait et personne ne voulait même plus lui donner de travail comme par le passé. C’était comme si chacun lui eût craché au visage; les hommes ne la regardaient plus comme une femme et lui adressaient d’ignobles propos. Parfois, très rarement, le dimanche, des ivrognes lui jetaient des sous par dérision. Marie les ramassait par terre sans mot dire Elle commençait déjà à cracher le sang. Ses haillons finirent par tomber en loques, au point qu’elle n’osa plus se montrer dans le village; depuis son retour elle marchait pieds nus. Alors les enfants – une bande d’une quarantaine d’écoliers – se mirent à lui courir après et même à lui jeter de la boue. Elle demanda au vacher la permission de garder ses bêtes, mais le vacher la chassa. Elle passa outre et accompagna le troupeau toute la journée sans rentrer chez elle. Elle rendit ainsi de précieux services au vacher, qui s’en aperçut et qui, cessant de la repousser, lui donna même parfois les restes de son repas, du pain et du fromage. Il considérait cela comme un grand acte de charité de sa part. Quand la mère mourut, le pasteur ne rougit pas de faire en pleine église un affront public à la jeune fille. Celle-ci se tenait en guenilles derrière la bière et sanglotait. Nombre de gens étaient venus là pour la voir pleurer et pour suivre le corps. Alors le pasteur – un jeune homme dont toute l’ambition était de devenir un grand prédicateur – s’adressa à l’assistance en lui montrant Marie: «Voilà, dit-il, celle qui a causé la mort de cette respectable femme (c’était faux, puisque la vieille était malade depuis deux ans); elle est là devant vous et n’ose pas lever les yeux, car elle est marquée du doigt de Dieu; elle est nu-pieds et couverte de haillons; qu’elle serve d’exemple à celles qui perdent leur vertu! Qui donc est-elle? Elle est la propre fille de la défunte!» Et il continua sur ce ton. Figurez-vous que cet acte de lâcheté fut du goût de presque tout le monde, mais… un événement imprévu s’ensuivit, car c’est alors qu’intervinrent les enfants, qui étaient déjà tous de mon côté et avaient commencé à prendre Marie en affection. Voilà comment ce revirement s’était produit. J’avais eu l’idée de faire quelque chose pour la jeune fille, mais ce qu’il lui fallait, c’était de l’argent et là-bas, je n’ai jamais eu un kopek à moi. J’avais une petite épingle avec un brillant; je la vendis à un brocanteur qui allait de village en village et faisait le commerce des vieux habits. Il m’en donna huit francs, bien qu’elle en valût certainement quarante. Je cherchai pendant longtemps à rencontrer Marie seule; enfin je la trouvai, hors du village, près d’une haie, derrière un arbre, sur un sentier de montagne. Je lui remis mes huit francs et lui dis d’en être économe, vu que je n’aurais plus d’autre argent. Puis je l’embrassai en la priant de ne me prêter aucune intention déshonnête: mon baiser était un geste de commisération et non d’amour. J’ajoutai que, dès le début, je ne l’avais jamais tenue pour coupable, mais seulement pour malheureuse. Je désirais vivement la consoler et la convaincre qu’elle n’avait pas lieu de se ravaler devant les autres; mais j’eus l’impression qu’elle ne me comprenait pas. Cette impression, je la ressentis tout de suite, bien qu’elle restât presque tout le temps silencieuse, debout devant moi, les yeux baissés et pleine de confusion. Quand j’eus fini de parler, elle me baisa les mains. Je saisis aussitôt les siennes pour les baiser à mon tour, mais elle les retira vivement. À ce moment-là toute la bande des enfants nous aperçut; par la suite j’appris qu’ils m’épiaient depuis longtemps. Ils se mirent à siffler, à battre des mains et à rire, ce que voyant, Marie prit la fuite. Je voulus leur parler, mais ils commencèrent à me jeter des pierres. Le même jour, tout le village connut l’événement; on retomba de nouveau sur Marie, à l’égard de laquelle l’hostilité s’accrut. J’ai même entendu dire qu’on avait projeté de lui administrer une correction, mais, Dieu merci, la chose n’alla pas jusque-là. Par contre, les enfants ne lui laissèrent plus de répit: ils la persécutèrent plus cruellement que par le passé et lui jetèrent de la boue. Ils lui couraient sus: elle s’enfuyait mais, comme elle était faible de poitrine, elle s’arrêtait à bout de souffle, tandis que les poursuivants lui criaient des injures. Un jour je dus même en venir aux mains avec eux. Puis je pris le parti de leur parler, de leur parler chaque jour, toutes les fois que je le pouvais. Parfois ils s’arrêtaient à m’écouter, mais sans renoncer à insulter Marie. Je leur exposai combien elle était malheureuse; alors ils ne tardèrent pas à se contenir et prirent l’habitude de passer leur chemin sans rien dire. Peu à peu nous multipliâmes nos entretiens; je ne leur cachais rien et leur parlais à cœur ouvert. Ils m’écoutaient avec une vive curiosité et se mirent bientôt à éprouver de la pitié pour Marie. Quelques-uns la saluèrent gentiment quand ils la rencontrèrent; c’est la coutume dans le pays de saluer les gens qu’on croise et de leur dire bonjour, qu’on les connaisse ou qu’on ne les connaisse pas. Je me figure la surprise de Marie. Un jour, deux fillettes se firent donner quelques livres qu’elles allèrent lui porter, puis elles vinrent me le dire. Elles racontèrent que Marie avait fondu en larmes et que maintenant elles l’aimaient beaucoup. Peu après il en fut de même de tous les enfants qui, du coup, se prirent également d’affection pour moi. Ils vinrent à maintes reprises me trouver en me priant tous de leur raconter quelque chose. À en juger par leur extrême attention à m’écouter, j’eus l’impression que je les intéressais. Dans la suite, je me mis à étudier et à lire dans le seul dessein de les faire profiter de ce que j’apprenais. Ce fut pendant trois ans mon occupation. Plus tard, lorsque tout le monde, y compris Schneider, me reprocha de leur avoir parlé comme à des adultes et de ne leur avoir rien caché, je répliquai que c’était une honte de mentir aux enfants, que ceux-ci n’en étaient pas moins au courant de tout, mais que, si on leur faisait des mystères, ils s’instruisaient sous une forme qui souillait leur imagination, ce qui n’était pas le cas pour ce que, moi, je leur apprenais. Sur ce point chacun n’a qu’à évoquer ses souvenirs d’enfance. Ce raisonnement ne les convainquit point. J’avais embrassé Marie deux semaines avant la mort de sa mère; aussi, lorsque le pasteur prononça son sermon, tous les enfants avaient déjà pris mon parti. Je leur rapportai et commentai sur-le-champ la façon d’agir du pasteur: tous s’en montrèrent révoltés et quelques-uns allèrent même jusqu’à lapider les vitres de ses fenêtres. Je m’efforçai de les retenir en leur représentant que c’était une mauvaise action; mais le village ne tarda pas à connaître cette affaire et l’on m’accusa de dépraver les enfants. Bientôt tout le monde sut que les écoliers aimaient Marie et cette nouvelle causa une vive alarme; mais Marie se sentait déjà heureuse. On eut beau interdire aux enfants de la voir; ils allaient en cachette la retrouver dans le champ où elle faisait paître les vaches; c’était assez loin, à environ une demi-verste du village. Ils lui portaient des cadeaux; quelques-uns n’y allaient que pour l’embrasser, lui donner des baisers et lui dire: Je vous aime, Marie [19], puis ils se sauvaient à toutes jambes. Marie avait peine à garder sa raison devant un bonheur si inattendu; elle n’avait pas même rêvé cela; elle était à la fois confuse et ravie. Le plus intéressant, c’était que les enfants, et surtout les petites filles, tenaient à courir lui répéter que je l’aimais et que je leur parlais très souvent d’elle. Ils lui disaient que c’était moi qui leur avais tout raconté et que désormais ils auraient toujours pour elle de la tendresse et de la compassion. Puis ils accouraient chez moi et me rendaient compte, avec des petites mines joyeuses et empressées, qu’ils venaient de voir Marie et que celle-ci m’envoyait ses compliments. Le soir j’allais à la cascade: il y avait là un endroit entouré de peupliers et complètement hors de la vue des gens du village; les enfants venaient m’y rejoindre, quelques-uns en cachette. Il me semble qu’ils prenaient un plaisir extrême à me croire amoureux de Marie et, durant tout le temps que je vécus là-bas, ce fut le seul point sur lequel je les induisis en erreur. Je n’eus cure de les détromper et de leur avouer que je n’aimais pas Marie, ou plutôt que je n’en étais pas amoureux et que je n’éprouvais pour elle qu’une grande pitié. Je voyais que leur plus vif désir était que mon sentiment fût tel qu’ils se l’imaginaient entre eux; aussi gardai-je le silence et leur laissai-je l’illusion d’avoir deviné juste. Il y avait dans ces petits cœurs tant de délicatesse et de tendresse qu’il leur paraissait, par exemple, impossible que leur cher Léon aimât autant Marie et que Marie fût si mal vêtue et allât nu-pieds. Figurez-vous qu’ils lui donnèrent des souliers, des bas, du linge et même quelques vêtements. Par quel miracle d’ingéniosité s’étaient-ils procuré tout cela? Je ne saurais le dire; toute la bande dut s’y mettre. Quand je les questionnai là-dessus, ils se contentèrent de rire gaîment; les petites filles battirent des mains et m’embrassèrent. J’allais parfois aussi voir Marie à la dérobée. Son mal empirait; elle se traînait à peine et avait fini par cesser tout service à la vacherie; toutefois elle partait encore chaque matin avec le troupeau. Elle s’asseyait à l’écart, à l’extrémité de la saillie d’un rocher presque abrupt; elle restait là comme immobile sur la pierre, cachée à tous les regards, depuis le matin jusqu’à l’heure où le troupeau rentrait. La phtisie l’avait tellement affaiblie qu’elle gardait presque tout le temps les yeux fermés et sommeillait, la tête appuyée contre le rocher. Sa respiration était difficile, son visage décharné comme celui d’un squelette; la sueur inondait son front et ses tempes. Je la trouvais toujours dans cet état. Je ne venais que pour un instant et ne désirais pas non plus que l’on me vît. Dès que j’apparaissais, Marie tressaillait, ouvrait les yeux et me baisait précipitamment les mains. Je ne les retirais plus parce que c’était pour elle un bonheur. Pendant tout le temps que j’étais là, elle tremblait et pleurait; parfois elle se mettait à parler, mais il était difficile de la comprendre. L’excès de son émotion et de sa joie la rendait comme folle. Les enfants venaient quelquefois avec moi; dans ce cas, ils se tenaient habituellement à distance et faisaient le guet à toute éventualité; l’exercice de cette surveillance leur plaisait infiniment. Quand nous étions partis, Marie, redevenue seule, se figeait à nouveau dans l’immobilité, fermait les yeux et s’appuyait la tête au rocher. Peut-être rêvait-elle. Un matin elle n’eut plus la force de suivre le troupeau et resta dans sa maison vide. Les enfants l’apprirent aussitôt et vinrent presque tous, ce jour-là, la voir à plusieurs reprises. Ils la trouvèrent alitée et abandonnée. Pendant deux jours, il n’y eut que les enfants à la soigner; ils se relevaient les uns les autres. Mais quand on sut au village que Marie approchait de sa fin, les vieilles vinrent à tour de rôle la veiller. Il semblait qu’on commençât à avoir pitié d’elle; du moins les gens du village laissaient-ils les enfants l’approcher et ne l’injuriaient-ils plus comme autrefois. La malade était tout le temps assoupie; son sommeil était agité et elle toussait affreusement. Les vieilles femmes chassaient les enfants, mais ceux-ci accouraient sous la fenêtre, ne fût-ce que pour une minute, le temps de dire: Bonjour, notre bonne Marie [20]. Dès qu’elle les apercevait ou entendait leur voix, elle se ranimait tout à fait, s’efforçait de se soulever sur ses coudes et les remerciait d’un signe de tête. Comme par le passé, ils lui apportaient des friandises, mais elle ne mangeait presque rien. Je vous assure que, grâce à eux, elle mourut presque heureuse; grâce à eux, elle oublia sa noire infortune. Et elle reçut en quelque sorte son pardon par leur entremise, car elle se considéra jusqu’au bout comme une grande criminelle. Semblables à de petits oiseaux qui seraient venus battre des ailes sous sa fenêtre, ils lui criaient chaque matin: Nous t’aimons, Marie [21]. Elle mourut beaucoup plus rapidement que je ne l’aurais pensé. La veille de sa mort, avant le coucher du soleil, j’allai la voir; elle parut me reconnaître et je lui serrai la main pour la dernière fois; comme cette main était décharnée! Le lendemain matin, on vint brusquement m’annoncer qu’elle était morte. Alors il devint impossible de retenir les enfants: ils couvrirent son cercueil de fleurs et lui placèrent une couronne sur la tête. À l’église, le pasteur, devant la morte, fit taire ses griefs; d’ailleurs il y eut peu de monde à l’enterrement, quelques curieux tout au plus; mais, au moment de la levée du corps, les enfants se précipitèrent en foule pour porter eux-mêmes le cercueil. Comme ils n’étaient pas de force à le faire, on les aida; tous escortèrent le convoi en pleurant. Depuis lors, la tombe de Marie est toujours pieusement entretenue par les enfants, qui l’ornent chaque année de fleurs et ont planté des rosiers tout autour. C’est surtout après cet enterrement que les gens du village se mirent tous à me persécuter à cause de mon influence sur les enfants. Les principaux instigateurs de cette persécution furent le pasteur et le maître d’école. On alla jusqu’à interdire formellement aux enfants de me voir, et Schneider prit sur lui de veiller à cette interdiction. Néanmoins nous réussissions à nous retrouver et nous nous faisions comprendre de loin par des signes. Ils m’envoyaient des petits billets. Par la suite, les choses s’arrangèrent, et tout dès lors alla pour le mieux; la persécution elle-même avait accru l’intimité entre les enfants et moi. Au cours de la dernière année je me réconciliai presque avec Thibaut et avec le pasteur. Quant à Schneider, il discuta longuement avec moi de ce qu’il appelait «mon système nuisible» à l’égard des enfants. Qu’entendait-il par «mon système»? Finalement, au moment même de mon départ, Schneider m’avoua la très étrange pensée qui lui était venue. Il me dit avoir acquis la pleine conviction que j’étais moi-même un véritable enfant, un enfant dans toute l’acception du terme. Selon lui, je n’avais d’un adulte que la taille et le visage; mais, quant au développement, à l’âme, au caractère et peut-être même à l’intelligence, je n’étais pas un homme; je ne le serais jamais, ajoutait-il, même si je devais vivre jusqu’à soixante ans. Cela me fit beaucoup rire; il était évidemment dans l’erreur, car enfin comment peut-on m’assimiler à un enfant? Toutefois, ce qui est vrai, c’est que je n’aime pas la société des adultes, des hommes, des grandes personnes; c’est une chose que j’ai remarquée depuis longtemps: je n’aime pas cette société parce que je ne sais pas comment m’y comporter. Quoi qu’ils me disent, quelque bienveillance qu’ils me témoignent, il m’est toujours pénible d’être au milieu d’eux et je suis ravi lorsque je peux aller au plus tôt rejoindre mes camarades; or mes camarades ont toujours été des enfants, non que je sois moi-même un enfant, mais tout simplement parce que je me sens attiré vers eux. Au début de mon séjour dans le village, je me promenais seul et triste dans la montagne; parfois il m’arrivait de rencontrer, surtout vers midi, heure de la sortie de l’école, la cohue bruyante des enfants qui couraient avec leurs gibecières et leurs ardoises au milieu des cris, des éclats de rire et des jeux. Alors toute mon âme s’élançait d’un coup vers eux. Je ne sais comment exprimer cela, mais j’éprouvais une sensation de bonheur extraordinairement vive chaque fois que je les rencontrais. Je m’arrêtais et je riais de contentement en regardant leurs frêles et petites jambes toujours en mouvement, en observant les garçons et les fillettes, qui couraient ensemble, leur gaîté et leurs larmes, car beaucoup d’entre eux, entre la sortie de l’école et l’arrivée à la maison, trouvaient le temps de se battre, de pleurnicher, puis de se réconcilier et de jouer à nouveau. Dans ces moments-là j’oubliais toute ma mélancolie. Depuis, pendant ces trois années, je n’ai pas pu comprendre ni comment ni pourquoi les hommes se laissent aller à la tristesse. Mon destin me portait vers les enfants. Je comptais même ne jamais quitter le village, et il ne me venait pas à l’esprit que je repartirais un jour pour la Russie. Il me semblait que je vivrais toujours là-bas; mais je finis par me rendre compte que Schneider ne pouvait plus me garder, et en outre un événement survint, d’une importance telle que Schneider lui-même me pressa de partir et écrivit ici en mon nom. C’est une affaire sur laquelle je vais maintenant me renseigner et consulter quelqu’un. Il se peut que mon sort change du tout au tout; mais ce n’est pas là l’essentiel. L’essentiel, c’est le changement qui s’est déjà produit dans ma vie. J’ai laissé là-bas bien des choses, trop de choses. Tout a disparu. Quand j’étais en wagon je pensais: je vais maintenant entrer dans la société des hommes; je ne sais peut-être rien, mais une vie nouvelle a commencé pour moi. Je me suis promis d’accomplir ma tâche avec honnêteté et fermeté. Il se peut que j’aie des ennuis et des difficultés dans mes rapports avec les hommes. En tout cas j’ai résolu d’être courtois et sincère avec tout le monde; personne ne m’en demandera davantage. Peut-être qu’ici encore on me regardera comme un enfant, tant pis! Tout le monde me considère aussi comme un idiot. Je ne sais pourquoi. J’ai été si malade, il est vrai, que cela m’a donné l’air d’un idiot. Mais suis-je un idiot, à présent que je comprends moi-même qu’on me tient pour un idiot? Quand j’entre quelque part, je pense: oui, ils me prennent pour un idiot, mais je suis un homme sensé et ces gens-là ne s’en doutent pas… Cette idée me revient souvent. Lorsque étant à Berlin je reçus quelques lettres que les enfants avaient trouvé le temps de m’écrire, je compris seulement alors à quel point je les aimais. C’est la première lettre qui m’a fait le plus de peine. Et quel chagrin ils avaient eu en me reconduisant! Depuis un mois déjà ils avaient pris l’habitude de me ramener à la maison en répétant: Léon s’en va, Léon s’en va pour toujours! [22] Chaque soir nous continuions à nous réunir près de la cascade et nous ne parlions que de notre séparation. Parfois nous étions gais comme auparavant, mais en me quittant pour aller se coucher ils me serraient dans leurs bras avec plus de vigueur et de fougue que par le passé. Quelques-uns accouraient à la dérobée, l’un après l’autre, pour venir m’embrasser sans témoin. Le jour où je me mis en route, toute la bande m’accompagna à la gare, distante d’environ une verste de notre village. Ils s’efforcèrent de retenir leurs larmes, mais beaucoup n’y parvinrent pas et se mirent à sangloter, surtout les petites filles. Nous marchions vite pour ne pas nous mettre en retard mais, de temps en temps, l’un ou l’autre de ces enfants se jetait sur moi au milieu de la route pour passer ses menottes autour de mon cou et m’embrasser, ce qui arrêtait la marche de toute la troupe. Si pressés que nous fussions, tout le monde s’arrêtait pour attendre la fin de ces épanchements. Quand j’eus pris place dans le wagon et que le train s’ébranla, tous les enfants me crièrent: hourra! puis ils restèrent sur place aussi longtemps que le wagon fut en vue. Moi aussi je les regardais… Écoutez: tout à l’heure, quand je suis rentré ici, je me suis senti, pour la première fois depuis ce moment-là, l’âme légère en voyant vos gracieux visages – car maintenant j’observe les visages avec beaucoup d’attention – et en entendant vos premières paroles; je me suis dit que j’étais peut-être en vérité un heureux de la vie. Je sais bien qu’on ne rencontre pas tous les jours des gens auxquels on s’attache de prime abord, et cependant je vous ai trouvées en descendant du train. Je n’ignore pas non plus qu’on éprouve généralement quelque honte à étaler ses sentiments, et pourtant je n’en éprouve aucune à vous parler des miens. Je ne suis guère sociable et ne reviendrai peut-être pas chez vous de longtemps. Ne prenez pas cela en mauvaise part; je ne veux pas dire par là que je vous dédaigne; ne croyez pas davantage que je sois froissé de quelque chose. Vous m’avez demandé l’impression que m’ont faite vos visages et les remarques qu’ils m’ont suggérées? Je vous répondrai bien volontiers. Vous, Adélaïde Ivanovna, vous avez un visage qui respire le bonheur: c’est le plus sympathique des trois. Outre que vous êtes fort jolie de votre personne, on se dit en vous voyant: «voilà un visage qui rappelle celui d’une bonne sœur». Avec vos allures simples et enjouées, vous n’en savez pas moins sonder rapidement les cœurs. Telle est ma pensée. Pour vous, Alexandra Ivanovna, vous avez aussi un très joli et très doux visage, mais peut-être existe-t-il chez vous quelque secrète tristesse. Votre âme est bonne à n’en pas douter, mais la gaîté en est absente. Il y a dans votre figure une nuance particulière d’expression qui fait songer à la madone de Holbein à Dresde. Ce sont là les réflexions que m’inspire votre visage; ai-je bien deviné? C’est vous-même qui m’attribuez le don de la divination. Quant à votre visage, Elisabeth Prokofievna, dit le prince en se tournant soudain vers la générale, j’ai, je ne dis pas l’impression, mais la simple conviction qu’en dépit de votre âge vous êtes une véritable enfant, en tout, absolument en tout, dans le bien comme dans le mal. Vous n’êtes pas fâchée que je m’exprime ainsi, n’est-ce pas? Vous savez quel respect je porte aux enfants? Et n’allez pas croire que je vous aie parlé si franchement de vos visages par pure simplicité d’esprit. Non, pas du tout. J’avais peut-être aussi mon arrière-pensée.