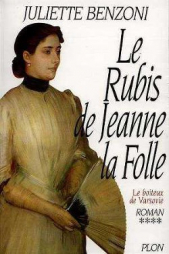La Marquise De Pompadour Tome I

La Marquise De Pompadour Tome I читать книгу онлайн
Un jour de 1744, Jeanne Poisson, belle jeune femme, rencontre, au hasard d'un bois, le roi Louis XV qui chasse, et obtient de lui la gr?ce d'un cerf. A la suite d'un chantage visant son p?re, Jeanne est bient?t oblig?e d'?pouser un homme qu'elle n'aime pas, Henri d'Etioles. Mais le roi a ? son tour succomb? au charme de Jeanne et leur idylle ?clate au grand jour. Les intrigues s'?chafaudent et de sinistres personnages comme le comte du Barry ou le myst?rieux M. Jacques manigancent dans l'ombre. Quel sera le destin de Jeanne?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XIV LA BASTILLE
Huit jours après les événements que nous venons de raconter. C’est une belle et radieuse journée. Un dimanche. Les rues de Paris sont pleines de promeneurs en habit de fête. La grande ville a cet aspect de gaieté bruyante qu’elle prend à de certains jours où le soleil, du haut du ciel sans nuages, verse à flots la joie et la vie.
Rue Saint-Antoine, les passants étaient plus nombreux que partout ailleurs. En effet, la rue Saint-Antoine, c’était la grande artère qui conduisait à la place Royale. Et la place Royale, aujourd’hui pétrifiée dans le souvenir du passé, silencieuse comme un impassible témoin de l’histoire, la place Royale que les enfants – ces moineaux de Paris – et les moineaux – ces gavroches de la nature – animent seuls de leurs piaillements, la place Royale était alors, disons-nous, le rendez-vous à la mode de toute les élégances parisiennes. Jeunes marquises en falbalas, la main haut gantée appuyée sur la canne enrubannée; jeunes seigneurs, le tricorne sous le bras, l’épée au côté; roués et courtisans, femmes galantes et dames du monde y coquetaient à qui mieux, et, suivant le vieux mot français si joli, si expressif, y fleuretaient en minaudant et en faisant mille grâces. (Le mot a été hideusement tronqué et, sous prétexte de nouveauté, on en a fait, de l’anglais: flirter.)
Dans cette foule bariolée, enrubannée, paniers à fleurettes, chapeaux de paille à grands pompons, cheveux poudrés; dans ces groupes qui se saluaient avec cette exquise afféterie, comme on se saluait dans les menuets; parmi ces promeneuses et promeneurs qui erraient sous les quinconces de la place Royale, il n’était bruit que de la fête que messieurs de l’Hôtel de Ville devaient offrir au roi.
Et la grande joie, dans ce monde joli, pailleté, léger, c’était de pouvoir s’aborder en disant:
– C’est fait! j’en suis! j’ai mon invitation!
– Comment, chère marquise, vous n’y serez pas?
– On dit des merveilles de la décoration…
– On parle d’un ballet où le roi figurera en personne. Cela s’appelle le Ballet de la clairière de l’Ermitage, et c’est plein de chasseurs, de dianes chasseresses et de nymphes…
– On dit aussi que le ballet s’appellera: La Fée de la clairière, ou le Cerf gracié…
Dans la rue Saint-Antoine, les promeneurs, plus serrés que sur la place Royale, s’occupaient simplement du pain qui renchérissait dans des proportions effrayantes, et des dernières levées d’impôts qui venaient d’être proclamées au tambour.
C’est que, là, c’étaient des gens du peuple qui passaient leur dimanche au bon soleil, ce grand et bon père de l’humanité qui verse à tous, ses clairs regards, pauvres et riches.
Et, comme nous l’avons dit, le soleil était ce jour-là si rayonnant que la gaîté l’emportait encore sur les lourdes inquiétudes du peuple.
Tout à coup, dans cette foule, des cris s’élevèrent.
Un carrosse lancé à fond de train accourait au fond de la rue, se dirigeant vers la Bastille au galop de ses deux chevaux, et menaçant de renverser quiconque ne se rangeait pas assez vite.
On se bousculait, on s’écartait en toute hâte, des grondements contenus s’élevaient, mais nul n’osait élever la voix.
Le carrosse passait comme un tonnerre.
Plusieurs personnes, cependant, avaient reconnu le personnage qui avait si peu de souci de la vie des gens.
– C’est ce méchant roué… ce flagorneur du roi…
– Le comte du Barry!…
– Va donc! hé! comte de six liards! cria un gamin.
Et aussitôt la colère qui commençait à gronder, cette colère qui, une cinquantaine d’années plus tard, devait si terriblement éclater, se fondait en une gaîté railleuse.
– Ohé! criait l’un. Où court-il donc si vite?
– Pardi! Il va à la Bastille!
– Qu’il y reste!…
Bien entendu, on ne s’esclaffait ainsi que lorsque le carrosse était déjà bien loin…
C’était le comte du Barry, en effet. Et c’était bien à la Bastille qu’il se rendait!…
Il était assis dans le fond de sa voiture, sombre et dédaigneux comme à son habitude. Devant lui, sur la banquette, se tenait modestement un homme vêtu comme un bourgeois qui eût tenu à ne pas trop se faire remarquer.
Cet homme tenait ses yeux baissés, gardait les coudes au corps, rentrait les jambes sous les genoux; bref, il semblait prendre à tâche de se faire aussi petit que possible, tandis que du Barry, au contraire, semblait, du haut de son jabot à dentelles, crier au simple piéton:
– Eh bien, oui, c’est moi! Malheur à qui se trouve sur ma route!…
Le carrosse, toutefois, s’arrêta sans avoir causé d’autre accident que quelques bousculades et quelques contusions, devant la porte Saint-Antoine.
Les deux hommes mirent pied à terre, et, franchissant le pont-levis, entrèrent dans la haute et noire forteresse qui semblait menacer Paris de ce même air de morgue et d’insolence dont le comte du Barry avait menacé les promeneurs de la rue.
L’officier de garde au poste, reconnaissant un des familiers du roi, se précipita au-devant du comte, le chapeau à la main.
– Faites-moi conduire au gouverneur, dit du Barry.
– Je vais avoir l’honneur de vous conduire moi-même, répondit l’officier avec cette suprême politesse des gens de bon ton d’alors, quand toutefois ils avaient ce bon ton!
Du Barry acquiesça d’un signe de tête et se mit à marcher derrière l’officier.
Son silencieux et modeste compagnon l’escortait…
Mais tandis que le comte ne prêtait aucune attention à ce qui l’entourait, cet homme ne put réprimer un frisson en pénétrant dans une cour étroite, humide, sans air ni lumière, et en entendant la porte se refermer lourdement derrière lui.
Et si du Barry avait pu pénétrer la pensée de son compagnon, voici ce qu’il eût entendu au fond de cette pensée:
– Diable!… mais c’est une tombe… une triste tombe… que cette forteresse! Dire que si on savait… si un mot maladroit échappait à ce du Barry… Oh! je frémis à l’idée que je serais enfermé là pour toujours… à moins qu’une bonne corde au cou…
Il n’acheva pas.
L’aspect intérieur de la Bastille était en effet terrible. Il régnait là une atmosphère mortelle; de hautes murailles noires où poussaient des mousses verdâtres, quelques étroites ouvertures dont les épais barreaux semblaient mettre une séparation suprême contre le monde des vivants et des malheureux qui gémissent dans ces cachots… voilà ce qu’on voyait…
Le pas monotone des sentinelles, le fric-frac sinistre d’un porte-clefs qui passe, le cri de ronde du sergent faisant une tournée… voilà ce qu’on entendait…
L’officier franchit une porte basse et monta un escalier tournant, aux marches de pierre à demi usées comme par des larmes, entre des murs où le salpêtre reluisait par places en brillants cristaux.
Au premier étage, il s’arrêta, donna un mot de passe à un factionnaire qui montait la garde devant une porte, frappa à cette porte et parlementa quelques instants avec le valet qui était venu ouvrir et qui rentra dans l’intérieur en faisant signe d’attendre.
Quelques instants plus tard, le comte du Barry et son compagnon étaient introduits dans un vaste cabinet sévèrement meublé, orné de vieilles tentures qui sentaient le moisi, et surtout de redoutables casiers qui portaient des numéros.
C’était bien là le cabinet d’un geôlier en chef.
Le gouverneur de la Bastille, vieillard au regard vitreux, entra, salua le comte avec une certaine déférence et coula vers l’étranger un mince regard qui fit frémir celui auquel il s’adressait.
– Quelles nouvelles, mon cher comte? demanda le gouverneur. Car dans ce trou je ne vois rien, je n’entends rien, je ne sais rien… Ah! vous êtes bien heureux, vous, de vivre à la cour!… Est-ce que mademoiselle de Châteauroux règne toujours sur le cœur de notre bien-aimé souverain?
Le comte du Barry tressaillit.
L’homme silencieux regarda le gouverneur avec une profonde attention, et murmura:
– Si cet homme-là n’est pas un imbécile, c’est un être redoutable… À surveiller!…
– Mlle de Châteauroux est morte, dit le comte du Barry, et si loin que vous viviez de la cour, vous ne me ferez pas croire…
– Bah!… dit flegmatiquement le gouverneur. D’honneur!… j’ignorais! Ah! elle est morte, cette pauvre Châteauroux!… Le ciel ait son âme!… Le grand Frédéric ne l’appellera plus Cotillon III.
Cette fois, l’homme silencieux se mordit les lèvres et du Barry devint livide.
– De quel grand Frédéric parlez-vous? balbutia-t-il.
– Mais… de l’unique, de l’illustre, du triomphateur… de l’ami de M. de Voltaire… du roi de Prusse, enfin!… Mais laissons cela, et voyons ce qui me procure le trop rare plaisir de votre visite…