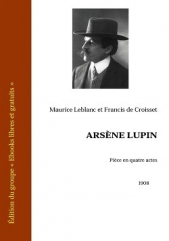Arsene Lupin, gentleman-cambrioleur

Arsene Lupin, gentleman-cambrioleur читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Une question se pose, et elle me fut souvent posée :
— Comment ai-je connu Arsène Lupin ?
Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j’accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j’expose, les preuves nouvelles que j’apporte, l’interprétation que je donne de certains actes dont on n’avait vu que les manifestations extérieures sans en pénétrer les raisons secrètes ni le mécanisme invisible, tout cela prouve bien, sinon une intimité, que l’existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies.
Mais comment l’ai-je connu ? D’où me vient la faveur d’être son historiographe ? Pourquoi moi et pas un autre ?
La réponse est facile : le hasard seul a présidé à un choix où mon mérite n’entre pour rien. C’est le hasard qui m’a mis sur sa route. C’est par hasard que j’ai été mêlé à l’une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures, par hasard enfin que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène, drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j’éprouve un certain embarras au moment d’en entreprendre le récit.
Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé. Et, pour ma part, disons-le tout de suite, j’attribue la conduite assez anormale que je tins en l’occasion, à l’état d’esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la Cascade, et, toute la soirée, tandis que nous fumions et que l’orchestre de tziganes jouait des valses mélancoliques, nous n’avions parlé que de crimes et de vols, d’intrigues effrayantes et ténébreuses. C’est toujours là une mauvaise préparation au sommeil.
Les Saint-Martin s’en allèrent en automobile. Jean Daspry, — ce charmant et insouciant Daspry qui devait, six mois après, se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, — Jean Daspry et moi nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j’habitais depuis un an à Neuilly, sur le boulevard Maillot, il me dit :
— Vous n’avez jamais peur ?
— Quelle idée !
— Dame, ce pavillon est tellement isolé ! pas de voisins… des terrains vagues… Vrai, je ne suis pas poltron, et cependant…
— Eh bien, vous êtes gai, vous !
— Oh ! je dis cela comme je dirais autre chose. Les Saint-Martin m’ont impressionné avec leurs histoires de brigands.
M’ayant serré la main il s’éloigna. Je pris ma clef et j’ouvris.
— Allons ! bon, murmurai-je, Antoine a oublié de m’allumer une bougie.
Et soudain je me rappelai : Antoine était absent, je lui avais donné congé.
Tout de suite l’ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu’à ma chambre à tâtons, le plus vite possible, et, aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clef et poussai le verrou.
La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant j’eus soin de tirer mon revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée, et je le posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchai et, comme à l’ordinaire, pour m’endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m’y attendait chaque soir.
Je fus très étonné. À la place du coupe-papier dont je l’avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe, cachetée de cinq cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagnés de cette mention : « Urgente ».
Une lettre ! une lettre à mon nom ! qui pouvait l’avoir mise à cet endroit ? Un peu nerveux, je déchirai l’enveloppe, et je lus :
« À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu’il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez plus, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri. Sinon, vous êtes perdu. »
Moi non plus je ne suis pas un poltron, et, tout aussi bien qu’un autre, je sais me tenir en face du danger réel, ou sourire des périls chimériques dont s’effare notre imagination. Mais, je le répète, j’étais dans une situation d’esprit anormale, plus facilement impressionnable, les nerfs à fleur de peau. Et d’ailleurs, n’y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d’inexplicable qui eût ébranlé l’âme du plus intrépide ?
Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier, et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes… « Ne faites pas un geste… ne jetez pas un cri… sinon, vous êtes perdu… » Allons donc ! pensai-je, c’est quelque plaisanterie, une farce imbécile.
Je fus sur le point de rire, même je voulus rire à haute voix. Qui m’en empêcha ? Quelle crainte indécise me comprima la gorge ?
Du moins je soufflerais la bougie. Non, je ne pus la souffler. « Pas un geste, ou vous êtes perdu », était-il écrit.
Mais pourquoi lutter contre ces sortes d’autosuggestions plus impérieuses souvent que les faits les plus précis ? Il n’y avait qu’à fermer les yeux. Je fermai les yeux.
Au même moment, un bruit léger passa dans le silence, puis des craquements. Et cela provenait, me sembla-t-il, d’une grande salle voisine où j’avais installé mon cabinet de travail et dont je n’étais séparé que par l’antichambre.
L’approche d’un danger réel me surexcita, et j’eus la sensation que j’allais me lever, saisir mon revolver et me précipiter dans cette salle. Je ne me levai point : en face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué.
Le doute n’était pas possible : il avait remué. Il remuait encore ! Et je vis — oh ! je vis cela distinctement — qu’il y avait entre les rideaux et la fenêtre, dans cet espace trop étroit, une forme humaine dont l’épaisseur empêchait l’étoffe de tomber droit.
Et l’être aussi me voyait, il était certain qu’il me voyait à travers les mailles très larges de l’étoffe. Alors je compris tout. Tandis que les autres emportaient leur butin, sa mission à lui consistait à me tenir en respect. Me lever ? Saisir un revolver ? Impossible… il était là ! au moindre geste, au moindre cri, j’étais perdu.
Un coup violent secoua la maison, suivi de petits coups groupés par deux ou trois, comme ceux d’un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit. Ou du moins voilà ce que j’imaginais, dans la confusion de mon cerveau. Et d’autres bruits s’entrecroisèrent, un véritable vacarme qui prouvait que l’on ne se gênait point, et que l’on agissait en toute sécurité.
On avait raison : je ne bougeai pas. Fut-ce lâcheté ? Non, anéantissement plutôt, impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres. Sagesse également, car enfin pourquoi lutter ? Derrière cet homme, il y en avait dix autres qui viendraient à son appel. Allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots ?
Et toute la nuit ce supplice dura. Supplice intolérable, angoisse terrible ! Le bruit s’était interrompu, mais je ne cessais d’attendre qu’il recommençât. Et l’homme ! l’homme qui me surveillait, l’arme à la main ! Mon regard effrayé ne le quittait pas. Et mon cœur battait ! et de la sueur ruisselait de mon front et de tout mon corps !
Et tout à coup un bien-être inexprimable m’envahit : une voiture de laitier dont je connaissais bien le roulement, passa sur le boulevard, et j’eus en même temps l’impression que l’aube se glissait entre les persiennes closes et qu’un peu de jour dehors se mêlait à l’ombre.
Et le jour pénétra dans la chambre. Et d’autres voitures passèrent. Et tous les fantômes de la nuit s’évanouirent.
Alors je sortis un bras du lit, lentement, sournoisement. En face rien ne remua. Je marquai des yeux le pli du rideau, l’endroit précis où il fallait viser, je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter, et, rapidement, j’empoignai mon revolver et je tirai.
Je sautai hors du lit avec un cri de délivrance, et je bondis sur le rideau. L’étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l’homme, je n’avais pu l’atteindre… pour cette bonne raison qu’il n’y avait personne.